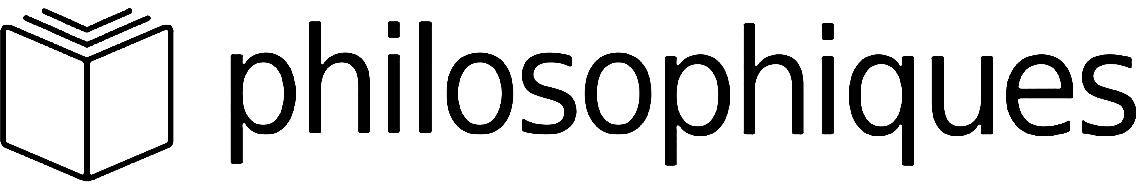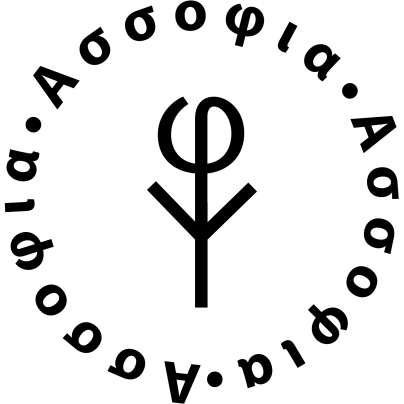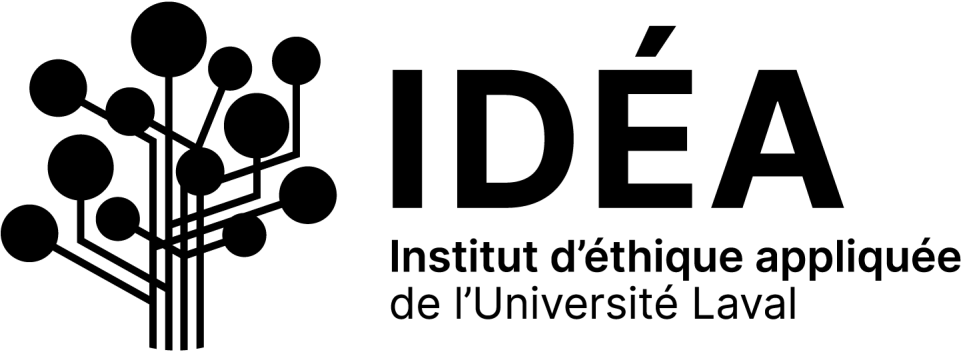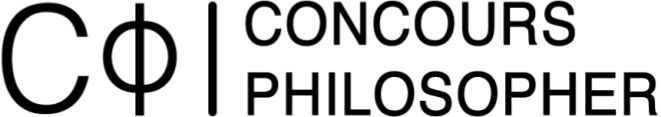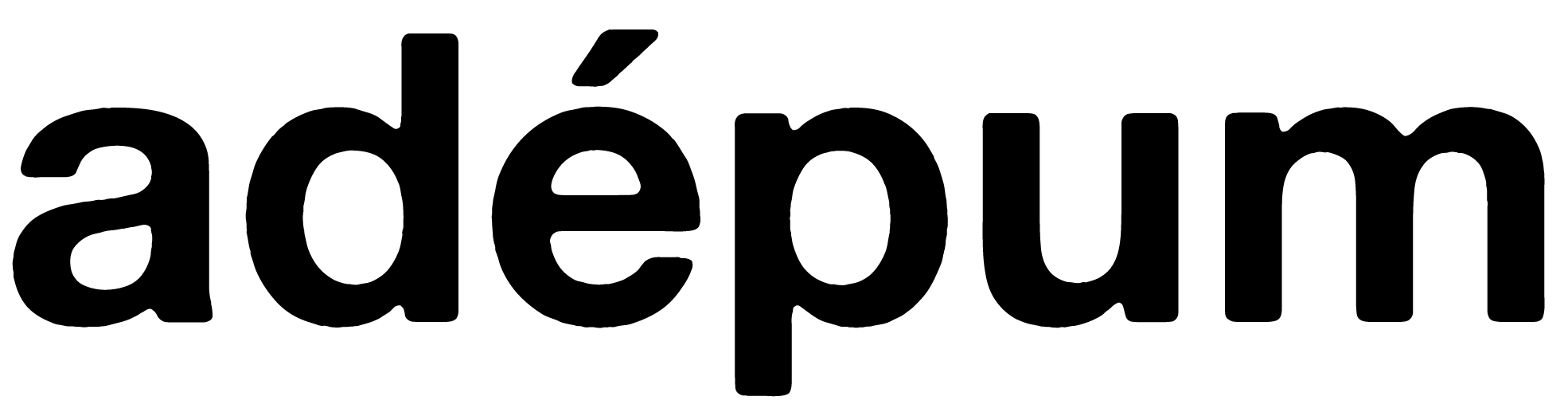No. 03 — Hors-thème
Entre l’inerte et le vivant : repenser la frontière
Christophe MalaterreDate de publication: 2025-07-01
Mots-clés: vulgarisation
Télécharger en PDF
Proposer une définition de la « vie » a toujours constitué une entreprise philosophique majeure, intimement liée à la quête de connaissance. La vie est une notion fondamentale, complexe, historiquement située et conceptuellement instable — ce qui explique la multiplicité des définitions qui se sont succédé au fil du temps. Dans l’Antiquité, Aristote l’associait à la possession d’une âme, établissant un lien essentiel entre vie et intériorité (Aristote 2005, II 2). Plus tard, Leibniz y voyait le produit d’une agrégation de monades, unités métaphysiques d’existence (Leibniz 1886, paragr. 63). À la veille de la biologie moderne, Buffon avançait que la vie relevait d’une propriété spécifique des molécules organiques (Buffon 1888, chap. 1). Quant à Kant, il identifiait la vie à l’organisation téléologique des corps naturels (Kant 2000, paragr. 66). Aujourd’hui, dans le contexte de l’astrobiologie et de la recherche en biologie synthétique, une définition souvent mobilisée est celle proposée par la NASA : la vie y est conçue comme un « système chimique auto-entretenu capable d’évolution darwinienne » (Joyce 1994, xi–xii).
Malgré leur diversité, la plupart de ces définitions partagent un présupposé implicite : celui d’une discontinuité nette entre le vivant et le non-vivant. Elles s’appuient sur l’idée d’un seuil, d’une frontière radicale que l’on pourrait identifier et localiser. Or, c’est précisément cette manière de poser le problème qui mérite d’être interrogée. Car où se situe exactement cette frontière ? Et que faire des entités qui défient nos catégories — ni pleinement vivantes, ni complètement inertes ? À rebours de cette tradition dichotomique, un certain nombre de travaux récents, en particulier en biologie synthétique, en chimie prébiotique et en philosophie des sciences, suggèrent au contraire l’existence d’une zone grise entre le vivant et le non-vivant, peuplée de systèmes hybrides, ambigus ou intermédiaires 1.
Face à cette situation, il devient nécessaire — et même urgent — de penser la vie en termes de gradualité plutôt que de discontinuité. Autrement dit, de reconnaître qu’il peut exister des degrés de vie, des entités qui manifestent certaines propriétés typiques du vivant sans nécessairement les cumuler toutes (Malaterre 2024). Cette approche gradualiste invite à déplacer le regard : au lieu de chercher une essence de la vie, il s’agit d’en cartographier les variations, les intensités, les seuils fonctionnels. En ce sens, la vie ne serait pas une condition binaire mais un espace continu, au sein duquel se situent une multitude de formes, de dynamiques, de devenirs biologiques possibles.
L’évidence du caractère binaire de la vie
Le principe selon lequel la vie serait une propriété binaire peut s’énoncer de la manière suivante :
(Bi) : Pour toute entité E, E est soit vivante, soit non-vivante.
Selon ce principe, la nature se divise en deux classes d’objets : ceux qui satisfont à une définition de la vie, et ceux qui n’y satisfont pas. Ce partage paraît souvent aller de soi. Dans la vie courante, nous éprouvons peu de difficultés à classifier les entités qui nous entourent comme vivantes ou non-vivantes : un chien, une bactérie, un arbre d’un côté ; une roche, un bâton, une flaque d’eau de l’autre. Ce geste classificatoire s’opère avec une telle évidence qu’il semble relever d’un automatisme perceptif ou conceptuel.
Cette évidence apparente s’ancre dans deux grandes oppositions structurelles, profondément enracinées dans notre rapport au monde. La première est celle qui oppose la vie à la mort (Bichat 1800). Il s’agit ici d’une opposition diachronique : une même entité peut passer d’un état à l’autre — elle était vivante hier, elle est morte aujourd’hui. Cette distinction est fondamentale, tant sur les plans affectif que pratique : elle régule nos interactions avec le monde, nos processus de deuil, nos décisions éthiques ou médicales (par exemple dans le cadre du don d’organes), ou encore notre capacité à détecter un danger (un ours vivant ne pose pas les mêmes enjeux qu’un cadavre d’ours).
La seconde opposition est de nature synchronique : elle distingue le vivant de l’inerte. Ici, on ne suit pas l’évolution d’une entité dans le temps, mais on compare simultanément des entités différentes — par exemple, un champignon et une pierre, une algue et un morceau de verre. Cette distinction nous permet, là encore, d’anticiper certains comportements ou interactions : une entité vivante peut se mouvoir, croître, se reproduire, et potentiellement représenter une menace ou susciter une obligation morale, tandis qu’une entité inerte est en principe stable, passive, sans agentivité propre.
Ces deux oppositions, vie/mort et vivant/inerte, soutiennent intuitivement le principe binaire (Bi) et guident notre appréhension du monde. On comprend dès lors pourquoi le caractère binaire de la vie s’impose avec une telle force dans l’expérience ordinaire.
Mais cette structuration n’est pas l’apanage du sens commun. Le principe (Bi) se retrouve aussi dans les sciences. Ainsi, les sciences médicales, la biologie cellulaire, la médecine vétérinaire, l’agronomie ou l’écologie s’appuient couramment sur l’opposition vivant/mort — ne serait-ce que parce que l’objectif de ces disciplines est souvent de prévenir ou de différer la mort. D’autres champs scientifiques, comme l’astrobiologie ou la recherche en biologie synthétique, mobilisent davantage l’opposition vivant/inerte, dans la mesure où leur tâche consiste à identifier, classer ou même créer des entités vivantes.
Dans ces différents domaines, le caractère binaire de la vie n’est pas explicitement affirmé comme un dogme, mais fonctionne comme une infrastructure conceptuelle implicite. En ce sens, le principe (Bi) jouit d’un double ancrage : il est socialement naturalisé dans le sens commun, et méthodologiquement intégré dans de nombreuses pratiques scientifiques.
Des doutes sur le caractère binaire de la vie
Bien que le principe binaire (Bi) bénéficie d’un large assentiment intuitif, il n’est pas pour autant invulnérable à l’épreuve des faits. Les oppositions qui le fondent se révèlent, à l’analyse, bien moins nettes et moins stables qu’on ne le suppose généralement.
L’opposition entre la vie et la mort, par exemple, peut sembler tranchée, mais des situations limites, médicales ou expérimentales, viennent brouiller la distinction. Le cas de la mort cérébrale, par exemple, met en lumière l’ambiguïté de ce passage supposément binaire. Un individu peut présenter une activité cellulaire résiduelle, conserver certaines fonctions physiologiques (comme la respiration assistée ou l’homéostasie), tout en étant déclaré juridiquement mort. Dans ces conditions, le seuil entre vie et mort devient incertain : il ne s’agit plus d’un simple basculement d’un état vers un autre, mais d’un processus gradué, d’une décomposition différentielle des fonctions vitales.
Quant à l’opposition vivant/inerte, elle se heurte à de nombreuses difficultés dans les sciences contemporaines. Le cas des virus est emblématique : longtemps exclus du domaine du vivant en raison de leur incapacité à se reproduire sans hôte, ils présentent néanmoins plusieurs propriétés typiquement associées à la vie — stockage d’information génétique, capacité d’évolution, sensibilité à la sélection naturelle. Certains virus dits géants (Mimivirus, Pandoravirus, etc.) possèdent même des caractéristiques cellulaires inattendues, remettant en question les critères classiques 2. D’autres entités moléculaires comme les prions, mais aussi des organismes endosymbiotiques aux capacités fonctionnelles extrêmement réduites complexifient encore davantage le tableau (Prusiner 1982; Norman, Hansen, et Sørensen 2009; Saunders et Stanley 1999; Nakabachi et al. 2006; Nakayama et al. 2014; Schvarcz et al. 2022).
De même, les recherches en biologie de synthèse et en chimie des systèmes donnent naissance à des objets hybrides, à mi-chemin entre l’inerte et le vivant : cellules à génomes minimaux, protocellules, systèmes auto-organisés, cycles métaboliques artificiels, ou encore réseaux moléculaires capables de reproduction et de variation (Hutchison et al. 1999; Hutchison et al. 2016). Ces entités manifestent certaines fonctionnalités typiques de la vie, sans pour autant satisfaire pleinement aux définitions conventionnelles. Elles révèlent l’existence d’un continuum fonctionnel, dans lequel les propriétés dites « vivantes » apparaissent de manière progressive, modulaire, contextuelle.
Ces exemples empiriques montrent que les frontières du vivant sont poreuses et contestables. Ils suggèrent que le principe (Bi), loin de reposer sur une nécessité conceptuelle ou une évidence ontologique, résulte d’un héritage classificatoire — historiquement situé, socialement stabilisé, mais scientifiquement fragile. En somme, la réalité biologique excède souvent les cadres binaires que nous lui appliquons. C’est pourquoi il est légitime de douter que la vie soit une propriété tout ou rien : elle pourrait bien, au contraire, s’étendre sur un spectre aux limites floues.
Conceptions de la vie en astrobiologie
L’astrobiologie constitue un terrain fertile de réflexion sur la nature de la vie. Domaine de recherche interdisciplinaire à la croisée de la biologie, de la chimie, de la géologie, de l’astronomie et des sciences planétaires, elle vise à comprendre l’origine de la vie sur Terre, mais également à explorer la possibilité de formes de vie ailleurs dans le système solaire — voire au-delà 3. Dans ce champ, l’opposition vivant/inerte y joue un rôle opératoire central, mais elle n’y est ni absolue, ni théorisée de manière univoque. Deux grandes orientations illustrent cette diversité d’approches du vivant.
La première relève de la vie synthétique. Ce champ de recherche ambitionne de créer, en laboratoire, des systèmes chimiques capables de reproduire certaines fonctions caractéristiques des êtres vivants — reproduction, métabolisme, auto-organisation, évolution (Blain et Szostak 2014; Toparlak et Mansy 2019; Ameta et al. 2021; Otto 2022). Il ne s’agit pas nécessairement de reconstituer l’ensemble des propriétés associées à la vie, mais d’atteindre un seuil minimal de complexité fonctionnelle, à partir duquel une entité pourrait être qualifiée de « minimalement vivante ». Cette approche ne présuppose pas une frontière nette entre le vivant et l’inerte : au contraire, elle explore l’espace intermédiaire entre les deux, dans le but de parvenir à synthétiser des systèmes vivants mais pris en un sens minimal.
La seconde approche est celle de la détection de biosignatures. Elle consiste à identifier, dans des environnements extraterrestres, des indices physico-chimiques ou morphologiques susceptibles d’indiquer une origine biologique (Des Marais et al. 2002; Catling et al. 2018; Schwieterman et al. 2018; Malaterre et al. 2023). C’est le cas, par exemple, des missions martiennes à la recherche de traces de vie passées ou présentes, mais aussi de la caractérisation d’exoplanètes bien au-delà de notre système solaire. Ici, l’enjeu est de disposer de critères suffisamment robustes pour distinguer ce qui relève véritablement du vivant, et d’éviter ainsi de fausses interprétations sur l’existence de vie extra-terrestre. Dans ce cas, on le comprendra, les traces de vie recherchées sont censées être celles de systèmes pleinement vivants ou pour ainsi dire « maximalement vivants ».
Ce que ces deux approches mettent en évidence, c’est la coexistence de conceptions opératoires différentes de la vie au sein d’un même champ de recherche. D’un côté, on cherche à produire des formes de vie minimales ; de l’autre, à détecter des formes de vie pleinement constituées. Cette tension apparente se résout aisément dès lors qu’on adopte une conception graduelle de la vie — une vision selon laquelle le vivant n’émerge pas au franchissement d’un seuil catégorique, mais se manifeste selon des degrés et des intensités variables.
Penser la vie en termes de degrés
Face à cette situation en astrobiologie et dès lors qu’on observe la nature avec suffisamment d’attention, il apparaît que le principe binaire de la vie (Bi) repose sur des fondations fragiles. Une alternative consiste à concevoir la vie non comme une propriété catégorique, mais comme un phénomène graduel : il existerait une zone de transition entre le vivant et le non-vivant, faite de seuils flous, de frontières souples, et d’intermédiaires ambigus. Cette perspective a été défendue dès le milieu du XXe siècle par N.W. Pirie, qui soulignait l’existence d’un espace d’indétermination entre l’inerte et le vivant (Pirie 1937). On peut ainsi proposer une reformulation du principe initial en un principe gradualiste :
- Pour toute entité E, E peut être vivante, non-vivante, ou plus ou moins vivante entre ces deux extrêmes.
Cette zone intermédiaire correspond à ce qu’on peut appeler un continuum de vie, un espace de « lifeness » (Malaterre 2010) ou de « degrés de vie » dans lequel les entités sont dotées de certaines propriétés caractéristiques de la vie, mais pas nécessairement toutes, et souvent seulement de façon partielle, limitée ou contextuelle.
Si on admet l’existence de cette zone grise, une question se pose alors immédiatement, celle d’évaluer plus spécifiquement ces « degrés de vie ». Une méthode consiste à modéliser la vie sur une échelle allant de 0 à 1, où 0 correspondrait à un état pleinement inerte, et 1 à une entité indiscutablement vivante (Bruylants, Bartik, et Reisse 2010; Bedau 2011). Les entités partiellement vivantes se situeraient entre ces extrêmes, leur position relative dépendant d’une comparaison de leurs capacités fonctionnelles avec celles d’entités paradigmatiques des états 0 et 1. Cette approche, cependant, rencontre une difficulté liée à la comparaison en bloc de propriétés éventuellement très disparates.
Pour remédier à cela, on peut affiner l’évaluation de degrés de vie en procédant en trois temps : (1) identifier les capacités fonctionnelles pertinentes manifestées par l’entité considérée ; (2) évaluer pour chacune de ces capacités leur degré de performance en comparaison avec les entités pleinement vivantes (point 1 de l’échelle) ; et (3) combiner ces évaluations pour produire un profil fonctionnel global de l’entité, sans forcément réduire celui-ci à une moyenne unique.
Ce profil fonctionnel multidimensionnel constitue ce qu’on peut appeler une « signature de de degrés de vie » (lifeness signature) : un vecteur de performances qui permet de situer précisément une entité dans l’espace graduel du vivant. Plutôt que de chercher une essence de la vie, cette approche permet d’en cartographier les expressions différentielles, selon les dimensions fonctionnelles effectivement manifestées.
Pour analyser et comparer les capacités fonctionnelles d’une entité cible plus-ou-moins vivante, une méthode—parmi d’autres—consiste à exploiter les publications scientifiques portant sur l’entité en question. L’analyse des thèmes abordés dans ces publications — reproduction, évolution, métabolisme, etc. — peut fournir une estimation indirecte des fonctions reconnues à l’entité. Plus une capacité est fréquemment mentionnée et analysée dans la littérature, plus on peut inférer qu’elle est jugée saillante, performante ou pertinente pour caractériser l’entité en question. Ainsi, l’intensité et la diversité des thèmes associés à une entité fournissent un indice empirique de sa complexité fonctionnelle, et donc de sa position dans l’espace du vivant (Malaterre et Chartier 2021).
Dans cette perspective, la zone entre l’inerte et le vivant apparaît comme peuplée d’entités ambiguës, partiellement vivantes — c’est-à-dire dotées de certaines propriétés du vivant mais pas nécessairement toutes, et réalisées à divers degrés sans nécessairement atteindre la performance fonctionnelle d’entités indiscutablement vivantes. Ces entités intermédiaires présentent ainsi des signatures globales de lifeness inférieures à 1 (moins performantes que les organismes vivants typiques), mais supérieures à 0 (elles manifestent plus de propriétés dynamiques que les objets purement inertes).
Cette approche permet d’expliciter conceptuellement et de modéliser empiriquement une conception gradualiste de la vie, que résume le principe (G). Elle offre ainsi une alternative à la vision binaire (Bi), et permet de mieux rendre compte de l’existence d’entités au statut ambigu. Loin d’être une exception marginale, le vivant partiel devient ici un objet central d’analyse qui nous oblige à repenser la vie comme un phénomène pluriel et gradué. Adopter cette approche, c’est reconnaître que la frontière entre vivant et non-vivant n’est pas une ligne nette, mais un espace transitionnel, riche en nuances, en défis conceptuels, et en opportunités pour penser autrement ce que signifie « être vivant ».
Une objection empirique au gradualisme ?
Une objection à l’approche gradualiste de la vie consiste à en contester la portée empirique. On pourrait, en effet, soutenir que les exemples d’entités intermédiaires entre vivant et non-vivant — qu’il s’agisse de virus, de protocellules synthétiques ou de systèmes chimiques prébiotiques — restent marginaux au regard de la diversité biologique observée. Le nombre limité de cas ambigus ne suffirait pas, selon cette objection, à remettre en question la robustesse du principe binaire (Bi) : la zone grise invoquée ne concernerait qu’un épiphénomène, et non une composante structurelle de la vie telle qu’elle existe. De surcroit, la rareté des cas intermédiaires identifiés laisserait intacte la possibilité qu’un seuil significatif sépare encore certains de ces cas, justifiant une reformulation du principe binaire : il suffirait de déplacer le seuil vers une zone intermédiaire, redéfinissant de nouvelles bornes du vivant et du non-vivant. Ce type d’objection revient à déplacer le débat : on concède l’existence d’une transition apparente, mais on soutient qu’un examen plus précis de cette zone pourrait y révéler un seuil ontologiquement robuste. En d’autres termes, on pourrait toujours redessiner une frontière franche à l’intérieur même de la zone grise identifiée, et ainsi restaurer le principe binaire sous une forme modifiée.
Mais cette objection néglige une donnée cruciale : l’existence même d’une zone grise, aussi restreinte soit-elle, suffit à invalider la prétention universelle du principe (Bi). En effet, la découverte de cas intermédiaires démontre que la distinction binaire ne saurait prétendre à une validité absolue. L’approche gradualiste ne nie pas l’existence des pôles — des cas paradigmes du vivant et du non-vivant — mais elle en complexifie l’intervalle.
De plus, rien n’empêche que ce déplacement suggéré de frontière vers un niveau de détail plus fin conduise à son tour à la découverte de nouvelles entités intermédiaires logées précisément entre les cas qui semblaient constituer les extrêmes de ce nouveau seuil. Il est même plausible de penser que c’est exactement ce qui s’est produit dans l’histoire récente des sciences du vivant : à mesure que de nouveaux organismes ou systèmes synthétiques sont explorés, le répertoire des entités ambiguës s’accroît, repoussant toujours plus loin la frontière initialement tracée. L’histoire empirique du vivant donne donc plutôt raison au gradualisme : plus on observe finement, plus on découvre de degrés.
Ce va-et-vient entre objection et contre-objection fait toutefois courir un risque : celui d’une régression à l’infini fondée sur des ajustements successifs du niveau de détail considéré. À chaque seuil proposé, on pourrait toujours imaginer une description plus fine révélant de nouveaux intermédiaires, et inversement proposer l’existence de nouveaux seuils entre entités intermédiaires nouvellement identifiées. Comment sortir de cette impasse ?
Une première réponse consiste à reconnaître que le niveau de détail descriptif est toujours contextuel et dépend des objectifs de recherche. Dans certains contextes — comme la recherche de biosignatures extraterrestres —, une approche binaire grossière peut s’avérer opérationnellement pertinente. À l’inverse, dans des cadres expérimentaux visant la création de proto-systèmes vivants, une granularité bien plus fine est requise pour mesurer des progrès incrémentaux dans la complexification fonctionnelle. Chaque contexte de recherche appelle ainsi un niveau de description adapté, et les principes binaire (Bi) ou gradualiste (G) peuvent chacun s’avérer localement pertinents. Il ne s’agit donc pas de choisir une fois pour toutes entre (Bi) et (G), mais de reconnaître leur validité respective dans des régimes épistémiques différenciés.
Une seconde réponse consiste à admettre que si un seuil existe, il ne peut désormais plus se situer entre le clairement non-vivant et le clairement vivant comme initialement envisagé. Les découvertes récentes forcent à reformuler le principe binaire en un nouveau principe (Bi’), où les bornes du vivant et du non-vivant ne sont plus les extrêmes classiques, mais des entités déjà ambiguës (virus, protocellules, artefacts synthétiques). Ce déplacement du seuil vers des zones de plus en plus fines traduit l’affaiblissement progressif du fondement intuitif du principe binaire : à mesure que l’on reformule (Bi) en (Bi’), la portée descriptive et normative du principe s’effrite. Il devient de plus en plus éloigné des distinctions opératoires issues du sens commun — entre une roche et une cellule, entre la mort et la vie — et de moins en moins capable de rendre compte de la complexité empirique actuelle.
La vie, entre relativisme épistémique et contraintes empiriques
Une seconde critique possible à l’approche gradualiste consisterait à y voir un relativisme radical : si la catégorisation du vivant dépend du niveau de détail adopté, alors toute réponse à la question de savoir si la vie est graduelle ou binaire devient purement contextuelle. On pourrait en conclure que la question elle-même perd toute portée : il n’y aurait plus de distinction ontologique à faire, mais seulement des usages du concept de vie dans des contextes particuliers.
Cette objection mérite d’être prise au sérieux, mais elle repose sur une confusion entre relativité contextuelle et absence de fondement. Ce n’est pas parce qu’une réponse à la question de la vie dépend d’un certain niveau de détail qu’elle en devient arbitraire. Un niveau de détail donné — choisi en fonction d’un cadre de recherche ou d’un problème spécifique — permet d’énoncer des jugements valides et pertinents dans ce contexte. Par exemple, une exobiologiste qui cherche des biosignatures sur Mars et un biologiste de synthèse qui tente de produire des proto-systèmes vivants en laboratoire n’ont pas besoin de partager exactement la même définition de la vie pour produire des connaissances empiriquement fécondes. La pertinence d’une démarcation — ou son absence — relève d’une convention opératoire ancrée dans des objectifs scientifiques précis, sans pour autant disqualifier la réalité des entités intermédiaires.
De plus, il existe une asymétrie importante entre gradualistes et partisans d’un seuil. Les premiers s’appuient sur des découvertes empiriques — virus géants, organismes à génome minimal, systèmes synthétiques — qui peuplent progressivement la zone intermédiaire, alors que les seconds projettent souvent sur cette zone des intuitions issues du sens commun. Or, les avancées scientifiques révèlent des contraintes empiriques auxquelles doivent se soumettre nos conceptualisations.
Ainsi, les recherches sur le génome minimal révèlent l’existence d’organismes viables avec des génomes nettement réduits. Visant à identifier, par des approches à la fois théoriques (phylogénie, génomique comparative) et expérimentales (suppression de gènes in vivo), l’ensemble le plus restreint de gènes nécessaires au maintien d’une forme de vie, ces travaux partent d’organismes comme la bactérie E. coli, et en réduisent les génomes, aboutissant ainsi à des entités dotées d’une complexité fonctionnelle amoindrie, bien qu’encore vivantes (Koonin 2003; Gil et al. 2004; Kobayashi et al. 2003; Hutchison et al. 2016). Face à de telles entités, deux options se présentent alors : soit on déplace la référence de ce qui est indubitablement vivant vers ces formes minimales ; soit on conserve un organisme original comme E. coli comme pôle de référence (avec un score de lifeness de 1) et l’on reconnaît que ces nouveaux organismes à génome minimal ont un degré de vie inférieur. Dans les deux cas, on déplace ou on dilue la frontière du vivant, et on creuse l’écart avec la vision binaire stricte (Bi) initiale.
À l’autre extrémité du spectre de recherches sur l’origine de la vie, les approches issues de la chimie prébiotique, de la chimie des systèmes et de la biologie de synthèse construisent, à partir de composés inertes, des systèmes possédant certaines propriétés du vivant — autocatalyse, compartimentation, croissance (Blain et Szostak 2014; Ameta et al. 2021; Otto 2022). Ces systèmes n’atteignent pas les performances fonctionnelles d’organismes unicellulaires comme E. coli, mais excèdent largement celles de systèmes chimiques indubitablement non-vivants.
Ce que ces travaux scientifiques démontrent, c’est que, si seuil il y a, celui-ci ne peut désormais se situer qu’entre des entités moins vivantes que E. coli mais plus vivantes qu’un composé chimique inerte. Les avancées de la recherche imposent des contraintes empiriques réelles, peuplent la zone grise de lifeness, et déplacent progressivement — voire dissolvent — les frontières strictes que postulait le principe binaire. (Bi) est alors contraint à reformulation en un (Bi’) articulé autour de nouvelles bornes qui ne recoupent plus celles de notre expérience quotidienne (entre roche et cellule), mais celles entre, par exemple, un organisme à génome minimal et un liposome catalytique. Or cette reformulation rend la thèse du caractère binaire de la vie de plus en plus en plus éloignée de nos intuitions initiales et de moins en moins défendable comme principe universel.
Repenser la vie à l’aune de ses transitions
Depuis l’Antiquité, définir la vie a constitué un défi théorique majeur, nourri par des intuitions, des oppositions conceptuelles et des pratiques classificatoires profondément ancrées. L’idée que la vie serait une propriété binaire — que toute entité serait soit vivante, soit non-vivante — continue de structurer nombre de nos représentations scientifiques et ordinaires. Pourtant, ce principe, aussi robuste qu’il puisse paraître, vacille à l’épreuve des faits contemporains. Les recherches en biologie synthétique, en chimie prébiotique et en astrobiologie peuplent notre univers conceptuel d’entités hybrides, partiellement vivantes, ni clairement inertes ni pleinement biologiques.
Loin de constituer de simples anomalies, ces entités intermédiaires signalent une transformation plus profonde : la nécessité de substituer à une logique du tout ou rien une pensée par degrés. Le vivant ne se laisse pas aisément enfermer dans une frontière nette ; il s’étale, se module, se spécifie selon des dimensions multiples. C’est ce que permet de penser une approche gradualiste : non pas l’abandon de toute distinction, mais leur reconfiguration dans un espace continu et multidimensionnel.
Cette reconfiguration n’entraîne pas un relativisme désengagé, mais une posture attentive aux contraintes empiriques que font émerger les sciences contemporaines. Le vivant devient alors non pas un état à identifier une fois pour toutes, mais une topologie à cartographier, un spectre à explorer.
En repensant ainsi la vie comme un phénomène gradué, nous ne la réduisons pas — nous lui rendons au contraire sa richesse : celle d’un monde où émergent, se transforment, et parfois disparaissent, des entités aux frontières mouvantes, dont le statut même invite à reconfigurer nos catégories les plus fondamentales.