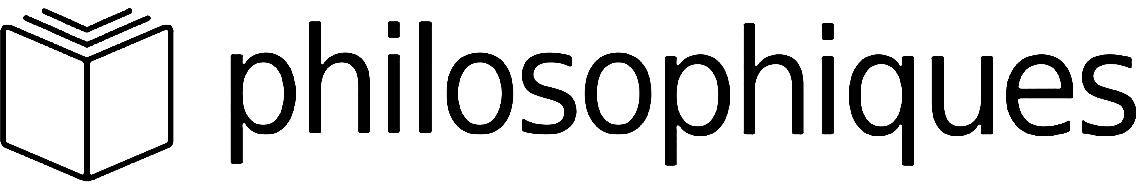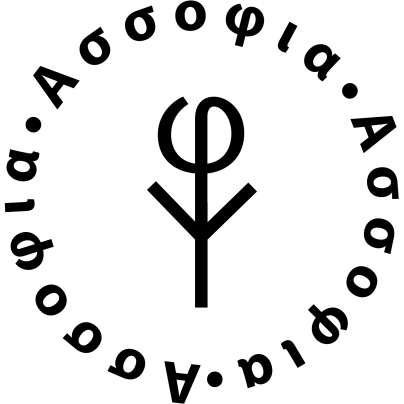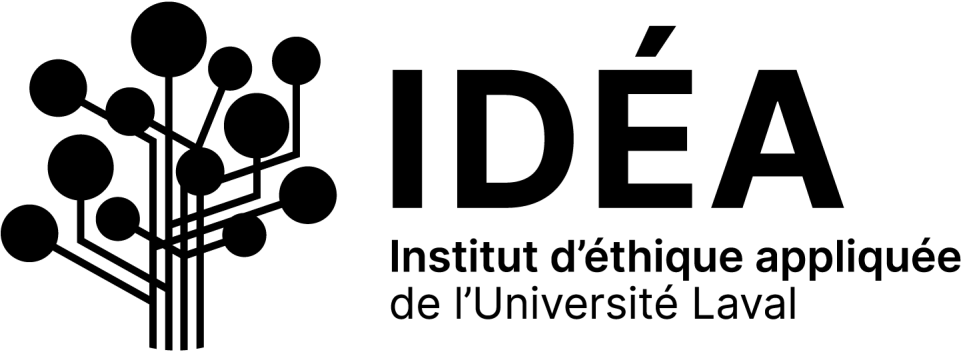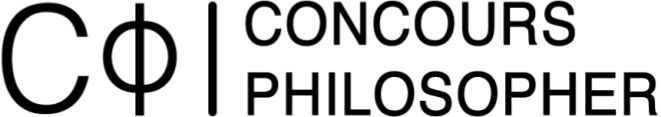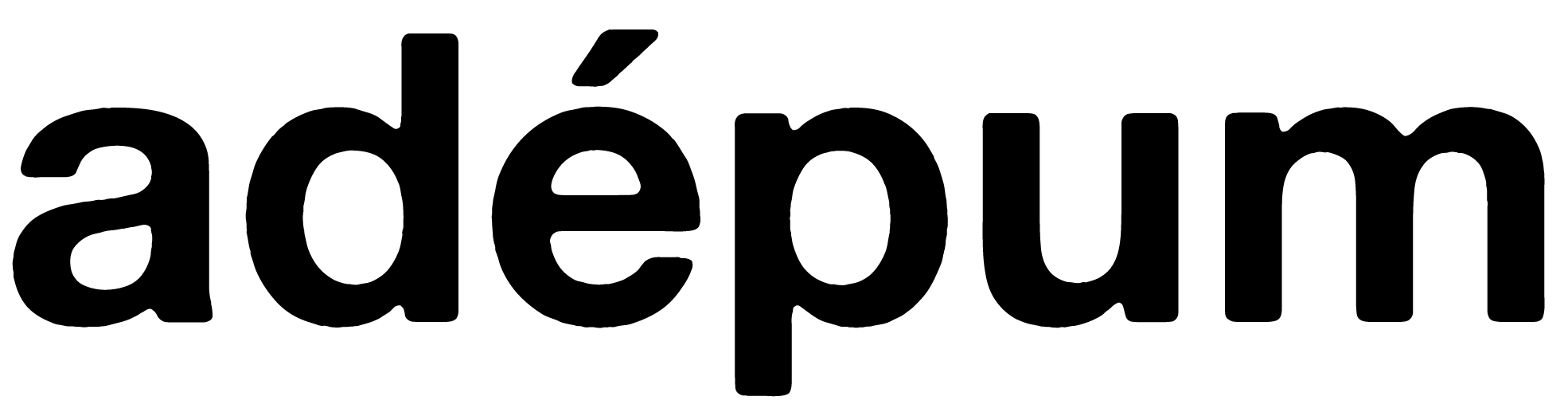No. 03 — Hors-thème
La nature est-elle réellement sanguinaire (red in tooth and claw) ?
Anne Fausto-SterlingTraduit par Antoine C. Dussault
Titre original: « Is Nature Really Red in Tooth and Claw? »
Date de publication: 2025-07-01
Mots-clés: traduction
Télécharger en PDF
Il est peut-être temps d’arrêter de concevoir le monde comme une jungle où tout le monde s’entre-dévore (a dog-eat-dog place).
Récemment, en zappant entre les chaînes de télévision, je suis tombée sur une publicité pour une série sur la nature intitulée The Trials of Life (Les épreuves de la vie). Le ton de la publicité, qui promettait des « séquences non censurées, choquantes et explicites » et des scènes d’un « royaume sauvage et indompté », donnait l’impression que la série était un film classé X. La regarder — c’est ce que prétendait la publicité — allait changer mon regard sur moi-même et sur la nature. Je découvrirais pourquoi nous appelons nos proches biologiques (et nous-mêmes, présumément ?) des animaux.
Je suis restée stupéfaite. Il est vrai que, depuis Darwin, les scientifiques de l’Europe occidentale et de l’Amérique conçoivent la nature comme férocement compétitive — « rouge de dents et de griffes », pour reprendre les termes saisissants d’Alfred, Lord Tennyson. Les manuels modernes discourent encore volontiers de la compétition féroce, de la survie du plus apte, comme de la force primordiale qui dirige l’évolution et détermine la façon dont les espèces interagissent. Pourtant, les recherches menées au cours des deux dernières décennies montrent que la coopération entre les espèces joue un rôle au moins aussi important que la lutte violente. « Les symbioses sont la règle plutôt que l’exception ; les organismes […] sont toujours associés à d’autres organismes », explique Betsey Dyer, biologiste au Wheaton College, dans le Massachusetts. Sans cette collaboration remarquable, la vie sur Terre telle que nous la connaissons n’aurait jamais existé, et encore moins prospéré.
La tendance à négliger le côté coopératif de la nature est d’autant plus surprenante que même la forme la plus poussée de coopération — l’alliance symbiotique de deux espèces distinctes — a été reconnue il y a plus d’un siècle (le mot grec symbiosis, qui signifie « vivre ensemble », a été utilisé pour la première fois en biologie par le botaniste allemand Heinrich Anton de Bary en 1879). Pourtant, pour des raisons qui relèvent moins de la science que de l’histoire, la plupart des scientifiques et des penseurs ont choisi d’ignorer le phénomène. Il est frappant de constater que ceux qui ont su apprécier le degré de coopération existant dans le monde naturel sont souvent ceux qui ont épousé une vision de la coopération dans la société humaine, notamment l’aimable révolutionnaire russe du XIXe siècle Pyotr Kropotkin, le socialiste allemand Friedrich Engels et, dans les années 1940, le quaker étatsunien Warder C. Allee. Les scientifiques vivent dans le monde réel, pas dans des tours d’ivoire, et leurs idées se développent dans un contexte social. C’est peut-être la raison pour laquelle une vision plus coopérative de la vie fait son retour. Les « flower children » des années 1960 sont les scientifiques actifs des années 1990. La guerre froide est terminée. L’état fragile de notre planète nous unit dans l’inquiétude. Et soudain, il semble que l’on puisse trouver de la coopération chez les plantes et les animaux, où que l’on regarde — ce qui laisse entrevoir une toute nouvelle image de l’évolution et de l’interdépendance entre toutes les formes de vie.
La symbiose et le mutualisme (pour les besoins de cet article, nous pouvons ignorer les distinctions techniques entre les deux) font tous deux référence à des cas où des organismes vivent ensemble et s’entraident. Les organismes peuvent être d’espèces très différentes, comme une anémone et un bernard-l’ermite, ou comme des coraux qui construisent des récifs et des algues. Beaucoup de ces arrangements sont très étonnants, et il est tentant de se pencher sur les plus spectaculaires d’entre eux. Comment ne pas mentionner le poisson-lampe de poche, qui attire des bactéries luminescentes dans des chambres à l’intérieur de son corps et en utilise ensuite leurs cultures pour éclairer son chemin dans l’océan sombre et échanger avec d’autres poissons-lampe de poche des informations sur le sexe et le danger ?
Mais ces exemples spectaculaires de symbiose ne sont probablement pas aussi importants que d’autres qui sont moins faciles à observer. Les interactions symbiotiques les plus importantes se produisent sous terre. On y trouve un vaste réseau souterrain de relations entre les champignons et les systèmes racinaires des plantes supérieures. Le terme technique est symbiose mycorhizienne (myco signifie champignon et rhizal fait référence aux racines). Les travaux menés au cours de la dernière décennie suggèrent qu’au moins 6 000 espèces de champignons peuvent interagir avec plus de 300 000 types de plantes supérieures ; en effet, au moins 70 % (et certains pensent que c’est le cas de 100 %) de tous les arbres, herbes, arbustes et fleurs prospèrent grâce à des interactions souterraines de longue durée avec un ou parfois plusieurs champignons. Ces champignons peuvent se développer à la surface des racines ou pénétrer profondément dans les cellules des racines de la plante. Ils produisent également des organes reproducteurs — qui sont ce que nous reconnaissons communément comme des champignons — au-dessus du sol.
Que donnent les plantes aux champignons ? Les plantes vertes pratiquent la photosynthèse : elles captent du dioxyde de carbone dans l’air et le transforment en carbone organique, la matière dont nous sommes tous faits. Pour réaliser ce tour de force, qui consiste à produire de la nourriture à partir de l’air, elles utilisent des structures appelées chloroplastes situées à l’intérieur de leurs cellules. Les champignons, en revanche, n’ont pas de chloroplastes et ne peuvent donc pas produire leurs propres composés carbonés. Mais en vivant dans le système racinaire de la plante, ils peuvent utiliser une partie de ce que la plante produit. L’écologie traditionnelle enseigne que les champignons qui poussent sur le sol de la forêt tirent leur carbone de la matière végétale en décomposition. Les spécialistes de la symbiose ont cependant montré que la plupart de ces champignons obtiennent leurs substances organiques plus directement, à partir des racines des plantes vivantes qu’ils habitent.
C’est très bien pour les champignons, mais quel est l’intérêt pour les plantes ? Une plante utilise ses racines pour absorber l’eau et les nutriments, tels que les minéraux et les éléments présents dans le sol, qui sont essentiels à une croissance saine. Plus les racines sont étendues, plus la surface dont elles peuvent tirer leur nourriture est grande. En période de sécheresse, par exemple, une plante dont le système racinaire est étendu s’en sortira mieux qu’une plante qui ne couvre qu’une petite surface. C’est là qu’interviennent les champignons. Ils vivent sous terre, formant de vastes réseaux filiformes qui peuvent couvrir des kilomètres de territoire ; leur association avec les racines des plantes étend la zone que les racines peuvent exploiter, améliorant ainsi l’absorption des nutriments par la plante. Il existe également des champignons qui stimulent les plantes en produisant des hormones de croissance. En outre, les champignons protègent les plantes en absorbant les éventuelles toxines. Certaines variétés défendent même le système racinaire contre les petits vers ronds, en utilisant leurs filets de filaments pour les piéger et les digérer.
Dans quelle mesure cette relation est-elle bénéfique ? En 1990, un groupe dirigé par F. T. Last, biologiste à l’université d’Édimbourg, a montré que les semis de conifères dont les racines contenaient peu de champignons ne poussaient que de deux pouces en deux ans, alors que ceux qui en contenaient 10 000 atteignaient dix pouces — une augmentation d’un facteur cinq.
Parfois, les relations symbiotiques impliquent des dizaines d’organismes en interaction. Comme beaucoup d’autres animaux, les termites ne peuvent pas digérer la cellulose, le principal composant du bois. Comment font-ils alors pour digérer le bois qu’ils arrachent de votre maison ou d’une souche d’arbre en décomposition ? Ils y arrivent avec l’aide de leurs amis : pas moins de 40 espèces différentes de bactéries, de spirochètes (bactéries longues et mobiles) et de protozoaires (créatures unicellulaires) vivent à l’intérieur de l’intestin des termites. Ces symbiotes bactériens et protozoaires transforment la cellulose en sucre pour se nourrir et pour nourrir leurs hôtes. Sans ces symbiotes, les termites pourraient ronger le bois ad nauseam, mais elles mourraient de faim.
Plus fascinants encore, les symbiotes des termites ont des symbiotes. L’un des principaux résidents de l’intestin des termites est un grand protozoaire appelé polymastigote. Cette bête a des milliers de spirochètes attachés à sa surface, ce qui lui donne l’apparence d’une cellule de chien hirsute. Propulsé par ces spirochètes, le polymastigote nage dans l’intestin, ramassant et digérant des fragments de bois. D’autres bactéries minuscules, semblables à des bâtonnets, vivent à la surface près des points d’attache des spirochètes, fournissant peut-être l’énergie chimique nécessaire à tous ces mouvements, mais le rôle réel de ces organismes et de beaucoup d’autres organismes de l’intestin des termites est encore hypothétique. Le polymastigote, par exemple, a lui aussi des bactéries et des spirochètes vivant à l’intérieur de son corps unicellulaire, mais leurs fonctions métaboliques sont encore inconnues.
Le système utilisé par les termites pour digérer l’indigestible pourrait également nous éclairer sur les forces qui ont façonné le comportement social de ces insectes. De nombreux termites vivent dans de grands nids, formant une colonie complexe dirigée par une reine qui pond des œufs. La ponte leur pose toutefois un problème. L’œuf est stérile ; aucun des symbiotes intestinaux n’y est présent. Pour ne pas mourir de faim, les jeunes larves doivent obtenir une dose de micro-organismes intestinaux en léchant l’anus de leurs gardiens, des larves plus matures destinées à devenir des soldats, des travailleurs et des reproducteurs. Cet échange vital entre les membres de la colonie de rang différent a peut-être été le point de départ de tous les comportements complexes qui font en sorte que chaque membre du groupe fait ce qu’il faut au moment où il le faut. En d’autres termes, le comportement social a peut-être évolué en raison de la nécessité de transférer des micro-organismes essentiels d’une génération à l’autre.
Le polymastigote, rendu poilu par son manteau composé de nombreux spirochètes, donne également une idée de la manière dont les cellules des organismes supérieurs se sont développées. L’idée que nos cellules sont des colonies de microbes a été suggérée pour la première fois dans les années 1920 par le biologiste américain Ivan Wallin. Aujourd’hui, en grande partie grâce à Lynn Margulis, biologiste de l’université du Massachusetts, cette idée s’est imposée dans la pensée contemporaine. (En effet, en accumulant les preuves, elle a fait passer Wallin du statut de scientifique à celui de visionnaire.) L’histoire est à peu près la suivante : au début, il n’y avait pratiquement pas d’oxygène libre dans l’atmosphère terrestre. Les premières bactéries à évoluer étaient donc anaérobies, c’est-à-dire capables de survivre sans oxygène. Ensuite, certaines bactéries ont développé la photosynthèse. Elles utilisaient l’énergie de la lumière solaire pour produire du carbone organique à partir des gaz présents dans l’atmosphère, libérant ainsi de l’oxygène. Finalement, d’autres bactéries ont utilisé l’oxygène pour respirer. La diversité et les talents des espèces bactériennes se sont accrus. Certaines sont devenues d’excellentes nageuses en développant des flagelles en forme de fouet, qui agissent comme des hélices, tandis que d’autres ont rampé comme des amibes, en étendant des pseudopodes (« faux pieds ») pour se tracter.
L’avenir des plantes et des animaux supérieurs était toutefois tributaire d’une nouvelle étape majeure de l’évolution. Les bactéries sont des cellules relativement simples — parfois comparées à des sacs de soupe enzymatique dans lesquels flotte du matériel génétique — mais les cellules des organismes supérieurs sont beaucoup plus sophistiquées. Tout comme notre corps possède des organes comme le cœur, les poumons et l’estomac, nos cellules possèdent de minuscules organites. L’un d’eux est le noyau (qui contient des chromosomes remplis de gènes), des mitochondries en forme de saucisse (chargées de la respiration) et des structures polyvalentes en forme de tubes appelées centrioles. Les centrioles constituent les modèles pour la fabrication des longs flagelles et des courts cils ondulés que les cellules utilisent pour la locomotion. Ils jouent également un rôle essentiel dans la reproduction de la cellule : ils aident les chromosomes à se diviser avec précision lorsque la cellule se sépare en deux, assurant ainsi la transmission fidèle de l’information génétique à la génération suivante. Les cellules végétales possèdent un autre organite. Il s’agit du chloroplaste, la structure mentionnée plus haut qui réalise la photosynthèse, convertissant le carbone atmosphérique en éléments organiques dont dépend la vie.
Comment ces cellules plus complexes ont-elles évolué à partir des bactéries primordiales ? Margulis l’explique par la « théorie de l’endosymbiose en série » de l’évolution cellulaire. Au début des années 1970, elle a proposé qu’à une époque reculée, des bactéries respirant de l’oxygène se seraient introduites dans des bactéries anaérobies de type amibes et auraient conclu un accord : nous respirerons pour vous si vous vous déplacez vers de nouveaux endroits contenant beaucoup d’oxygène pour y trouver de la nourriture. Il ne fait guère de doute que ces bactéries respirant l’oxygène sont les ancêtres de nos mitochondries.
Le nouvel hybride s’est ensuite associé à des spirochètes tubulaires. Margulis pense que cette amitié ressemblait à celle qui s’est développée entre le polymastigote des termites et ses amis spirochètes. Les spirochètes agiles ont aidé leurs partenaires à naviguer et à trouver les meilleurs endroits pour se nourrir, et les ont même aidés à recueillir la nourriture dans leurs bouches. Finalement, ils sont devenus des accessoires permanents. Ils ont aidé la cellule à fabriquer des flagelles et des cils. En outre, ils ont perdu la majeure partie de leur matériel génétique propre et ont aidé leurs hôtes à se reproduire. La bactérie amibienne d’origine, désormais composée de trois organismes vivant en symbiose, est devenue la cellule (avec un noyau, des mitochondries et des centrioles) présente aujourd’hui chez les animaux supérieurs. Certaines de ces créatures unicellulaires ont évolué vers les organismes multicellulaires que nous connaissons aujourd’hui comme les animaux et les champignons. D’autres ont acquis une bactérie photosynthétique et sont devenues des algues : des organismes unicellulaires qui, comme les plantes supérieures, exploitent l’énergie solaire pour produire du carbone.
Bien que certaines des idées de Margulis restent controversées, de nombreux laboratoires accumulent des preuves confirmant ce scénario symbiotique. En effet, depuis le milieu des années 1970, la recherche scientifique sur tous les aspects du mutualisme et de la symbiose a augmenté de façon spectaculaire. Pourtant, il faut un temps étonnamment long pour comprendre l’importance de ces phénomènes. L’édition 1991 d’un manuel de biologie universitaire standard, An Introduction to Evolutionary Ecology, comprend huit entrées sur la compétition dans son index, mais seulement deux sur le mutualisme et aucune sur la symbiose. Une section intitulée « Pourquoi y a-t-il tant d’espèces ? » consacre quatre paragraphes au rôle de la compétition, mais ne mentionne jamais l’idée voulant que l’acquisition de nouveaux symbiotes joue un rôle majeur dans l’évolution de nouvelles espèces.
Que se passe-t-il ? Pourquoi la coopération est-elle ignorée depuis plus d’un siècle par tant de scientifiques ? Et pourquoi a-t-elle été ridiculisée tout particulièrement dans l’Occident capitaliste ? La vision de notre monde économique et social comme une jungle où tout le monde s’entre-dévore (a dog-eat-dog place) nous a-t-elle empêché-e-s de donner au mutualisme ses lettres de noblesse ?
L’histoire suggère certainement que c’est le cas. À la fin des années 1880 et au début des années 1890, par exemple, un débat entre l’évolutionniste britannique T. H. Huxley et le révolutionnaire et scientifique russe Kropotkine a éclaté dans les pages d’un magazine londonien intitulé The Nineteenth Century (Le dix-neuvième siècle). Huxley pensait que la compétition était la force motrice et progressive de la nature et qu’il n’y avait pas lieu de se tourner vers la nature comme guide moral. « Du point de vue du moraliste, écrivait-il, le monde animal est comparable à un spectacle de gladiateurs ». Kropotkine, dans des articles rassemblés plus tard dans un livre populaire intitulé L’entraide, soutenait que Huxley déformait les idées originales de Darwin. Ses observations minutieuses des animaux luttant pour survivre dans le rude climat sibérien l’avaient convaincu que le mutualisme était un facteur déterminant dans la nature : loin de se livrer à une compétition acharnée, la plupart des animaux coopéraient dans l’intérêt de leur survie. En fin de compte, ces observations l’ont amené à rejeter le capitalisme exploiteur qui avait apporté la pauvreté et le désespoir à de nombreuses personnes dans sa chère Russie prérévolutionnaire.
Pour Kropotkine, la biologie indiquait une meilleure manière de vivre. Le point de vue de Huxley sur la biologie, cependant, a été largement interprété comme signifiant que le capitalisme — quoi qu’il en soit de ses inégalités — ne faisait que suivre la loi de la nature. (En toute justice envers Huxley, cependant, il pensait pour sa part que les humains devaient s’élever au-dessus d’un tel comportement méchant et brutal.) Parmi les intellectuels préoccupés par cette question, on trouve le socialiste marxiste Engels. « La théorie darwinienne de la lutte pour l’existence », pensait-il, consistait en une « transposition de la société à la nature organique ». Une fois que les penseurs eurent transféré l’idée de lutte de la culture capitaliste à la nature, ce n’était qu’une question de temps avant qu’ils ne transfèrent « ces théories à nouveau, de l’histoire naturelle à celle de la société ». Pour Engels, la théorie scientifique est née de la croyance sociale et a ensuite servi à la renforcer.
La confrontation entre Huxley et Kropotkin est le reflet d’un intense débat en matière de politique sociale sur la compétition et la lutte dans l’Europe du dix-neuvième siècle. Ce débat était bien entendu structuré par les effets de la révolution industrielle, qui avait créé une richesse indéniable pour certains, mais avait également causé d’énormes difficultés pour d’autres. En général, les dirigeants d’entreprises avaient tendance à adopter une vision compétitive du monde. Les travailleur-euse-s, quant à eux et elles, ont réagi aux bouleversements en formant des syndicats et des sociétés d’entraide.
Dans les années 1940, l’intérêt pour le mutualisme s’est répandu aux États-Unis. L’un de ses principaux partisans était le biologiste Warder C. Allee, un quaker qui voulait utiliser ses connaissances en zoologie pour construire un monde sans guerre et qui, en 1949, a écrit un livre influent, Principles of Animal Ecology ; contrairement aux livres actuels, ce texte comportait plusieurs entrées d’index sous les thèmes du mutualisme et de la symbiose. Mais au milieu des années 1950 (l’époque de la guerre froide, du maccarthysme et de la chasse aux sorcières anticommunistes), le vent a tourné. Une vision tout à fait différente de l’écologie s’est à nouveau imposée — une vision dans laquelle les organismes sont en compétition pour les ressources.
Il a semble-t-il fallu l’agitation de la fin des années soixante et des années soixante-dix, les années du flower power, des marches contre la guerre et de l’activisme pour les droits civiques, pour que s’ouvre un espace intellectuel propice au renouveau de l’intérêt pour le mutualisme et la symbiose. Les recherches de Douglas Boucher, biologiste et historien à l’Université du Québec, font état de cette progression. En 1985, il a recensé les publications où était présenté un modèle mathématique d’interactions mutualistes. La première, publiée en 1935, n’a pas eu de suite avant que deux autres paraissent au milieu des années 1960. Au cours des années 1970, il y a eu 17 publications, et le rythme s’est accéléré tout au long des années 1980.
Malgré cela, l’acceptation n’est pas assez rapide pour satisfaire Mark Bertness, biologiste à l’université de Brown. Bertness étudie l’interaction entre les différentes espèces qui peuplent les marais salants de Nouvelle-Angleterre. Sous des conditions favorables, ces organismes sont en compétition, mais sous des conditions de stress, Bertness a découvert qu’ils se comportaient de manière mutuellement bénéfique. Par exemple, pour résister aux assauts de la mer, les moules côtelées s’installent en grand nombre parmi les petites herbes qui poussent sur les vasières côtières. Les moules s’attachent aux herbes des marais à l’aide de fils, ce qui leur permet de s’ancrer dans le sol et de s’attacher à d’autres herbes moins résistantes. En outre, elles nourrissent les plantes en déféquant juste au-dessus de leur système racinaire. « C’est un cas parfait de mutualisme », explique M. Bertness. Les vasières accueillent également des légions de crabes appelants. À l’instar de milliers de tracteurs John Deere, ces crabes labourent le sol, l’aèrent et facilitent ainsi la pénétration des racines des herbes. « Si on les enlève, la croissance des herbes diminue d’environ 50 pour cent pour une saison de pousse », explique M. Bertness.
Le message général de Bertness est que dans les moments difficiles, les plus tenaces coopèrent. Mais son message se heurte à plusieurs critiques. Ses détracteurs affirment que ses résultats concernant les moules, les crabes et les plantes des marais ne sont pas généralisables à d’autres systèmes écologiques, comme les forêts et les prairies. « C’est une question de point de vue », dit Bertness, convaincu que ce qu’un-e scientifique croit au départ conditionne ce qu’il recherche. « Ce type d’interaction sera courant dans les forêts et les prairies également », insiste-t-il. « Tout dépend du contexte physique — favorable ou défavorable ».
Quel bilan pouvons-nous tirer de tout cela ? Tout d’abord, des arguments de poids plaident en faveur d’une vision de la nature comme semblable à une coopérative socialiste (« verte en racines et en fleurs », comme l’écrit Boucher pour contrecarrer le « rouge de dents et de griffes » de Tennyson). Je présume qu’une vision équilibrée finira par émerger, celle d’organismes marqués autant par la coopération que par la lutte. Mais cela ne se produira pas parce que nous aurons soudainement découvert le mutualisme et la symbiose. Nous en savons déjà beaucoup sur ces processus, et il est clair qu’ils sont très répandus et qu’ils revêtent une grande importance pour l’écologie et l’évolution. Seul un changement de contexte social permettra à ces idées déjà existantes de s’intégrer à la pensée biologique dominante.
La connaissance scientifique ne se développe pas en vase clos. Elle ne jaillit pas tout bonnement des fontaines de la nature. Elle n’est pas non plus alimentée par la seule force des idées. Au contraire, nous la construisons avec les outils de pensée disponibles dans notre culture particulière à un moment particulier de l’histoire. Peut-être que si nous devenons un jour une nation plus aimable et plus douce, le mutualisme et la symbiose se verront accorder la place qu’ils méritent dans la théorie scientifique.1
NDLR: Traduit de l’anglais par Antoine C. Dussault. Texte original paru en 1993 dans Discover, 14, 4, p. 24−27. Le travail sur cette traduction a bénéficié du soutien financier du Fonds de recherche du Québec – Société et Culture (FRQSC, 2024-PEC-335614).↩︎