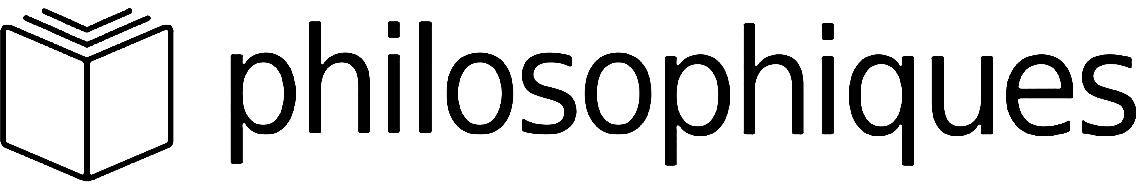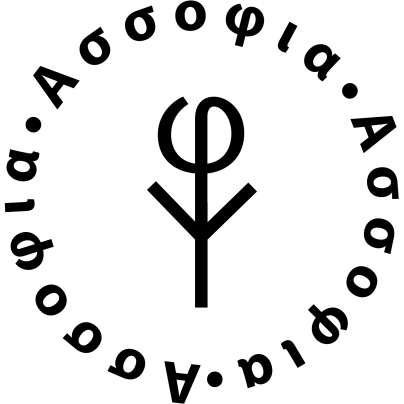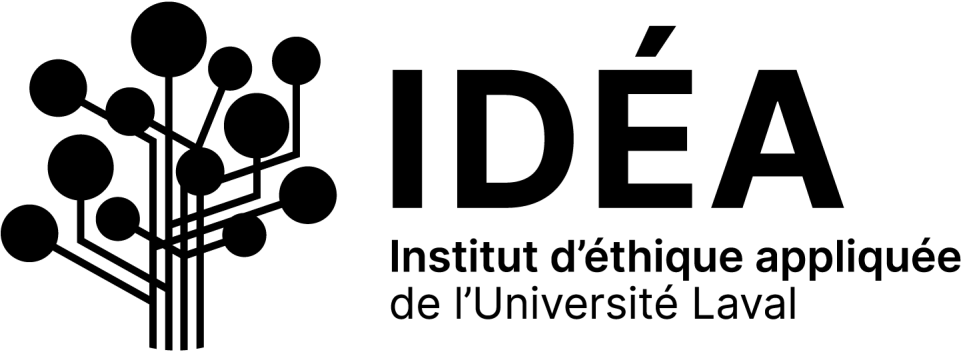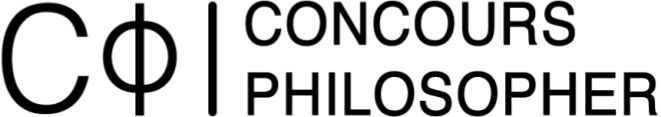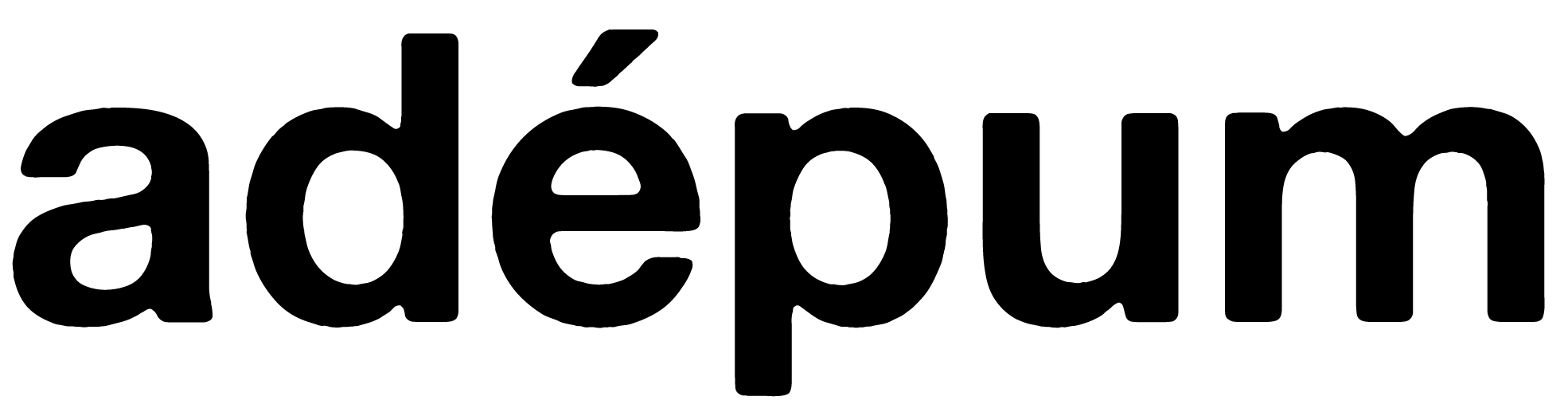No. 03 — Philosophie et environnement
Une valeur de la nature au-delà de l’humain ?
Ariane Godin, Collège AhuntsicDate de publication: 2025-07-01
Mots-clés: érudite, valeur, écosystème, intrinsèque, organisme, humain
Télécharger en PDF
L’idée qui vient souvent en premier lieu quand on pense au concept de valeur ou d’évaluation, est celle qu’il n’y a que l’humain qui puisse effectuer une telle tâche de « valoriser », d’« évaluer ». Voilà donc que l’humain a créé, consciemment ou non, une sorte de charte de valeur. On pourrait séparer la valeur en trois grands champs : la valeur monétaire, la valeur esthétique et la valeur intrinsèque. La valeur monétaire se réfère à l’évaluation d’un bien selon un prix. Le temps, les ressources, le territoire sont des exemples de biens que l’humain monétarise pour en simplifier l’usage. La valeur esthétique est moins calculable ; elle se réfère à ce qui est beau au sens général, mais, surtout, à ce qui ne laisse pas indifférent, ce qui est grandiose. On pourrait ici prendre l’exemple d’une réserve naturelle comme celle du Parc national du Bic. Rares sont ceux qui ne sont pas touchés par l’envoûtement naturel qu’appelle en nous la forêt et les grands rochers qui s’avalent dans le fleuve. Enfin lorsqu’on parle de valeur intrinsèque, on entend par là l’idée de ce qui bon en soi (McShane 2007).
Dans ce texte, il sera question d’évaluer la valeur intrinsèque d’un organisme (McShane 2007), terme qui pourrait brièvement être défini selon Lamarck (1802) comme étant un corps qui forme lui-même sa propre substance à partir de celle qu’il puise dans le milieu. Autrement dit, un organisme est dépendant de son environnement pour forger sa propre existence. Il ne sera pas question de monétiser son existence ou de se prononcer sur sa valeur esthétique. Ce texte cherchera à comprendre comment peut être prouvée la thèse que la nature a une valeur au-delà de ce que l’humain puisse en penser. D’ailleurs, la valeur de la nature, dans ce texte, sera expliquée en fonction des organismes qui la composent, vu la complexité de définir un terme aussi large que celui de « nature ».
Biocentrisme : exemple de l’arbre et des animaux, preuve de la valeur intrinsèque
Rolston a une conception non-anthropocentriste de la question : il défend l’idée que ce ne sont pas que les humains qui ont une valeur intrinsèque, mais les organismes aussi (Boslaugh 2016). C’est donc une théorie biocentriste que défend Rolston : il croit que les organismes possèdent une valeur pour eux-mêmes.
Dans son ouvrage A New Environmental Ethics, Rolston donne deux exemples pour expliquer sa théorie et clarifier ce qu’il entend par « valeur intrinsèque ». Il tente de prouver qu’autant les membres du règne végétal que ceux du règne animal ont une valeur en soi.
D’abord, il présente l’histoire d’un arbre. Il explique qu’un arbre qui, par exemple, se ferait abimer l’écorce par les cornes d’un cerf, aurait intrinsèquement le réflexe de faire couler sa sève dans l’entaille pour amorcer un processus de réparation. Rolston fait ressortir de cet exemple que l’arbre est « value-able » (Rolston 2020), ou, pourrait-on traduire en français, « capable de valeur », capable de reconnaître sa propre valeur. Autrement dit, l’arbre à naturellement le « désir » de survivre ; il valorise son existence.
Quant aux animaux, ils ont eux aussi la capacité de valoriser et de se valoriser, nous dira Rolston (2020). En effet, ils valorisent intrinsèquement leur existence et leur maintien individuel et collectif, puisqu’au sein de leurs espèces respectives, les animaux s’accordent une valeur à eux-mêmes et à leur survie (Rolston 2020). De plus, ils valorisent instrumentalement leurs ressources.
De façon plus générale, Rolston (2020) soutient que les organismes expulsent le désordre qui règne autour d’eux. Autrement dit, ils accordent de la valeur à leur existence puisqu’ils utilisent les moyens dont ils disposent pour perdurer et survivre au chaos de leur environnement. Bref, puisque les organismes valorisent par eux-mêmes leur existence et font tout pour la maintenir, en dehors de toute évaluation humaine, Rolston affirme que les organismes sont dotés d’une valeur intrinsèque.
Cependant, Rolston (2020) souligne que chaque espèce est centrée sur elle-même, l’humain n’y faisant pas exception ! D’ailleurs, c’est selon lui cet autocentrisme qui crée ce qu’il appelle les priorités éthiques. C’est-à-dire que les êtres vivants priorisent leur existence face au péril d’une autre. Cela étant, Rolston (2020) reconnaît que l’humain possède la capacité d’être altruiste et de réfléchir sa relation avec les autres organismes qui composent son environnement.
Ce qui mène à l’interrogation suivante : quelle est la responsabilité de l’humain face à la conservation des écosystèmes, ou, plus concrètement, face à la pérennité des organismes qui les composent ?
Rolston (2020) répond à cette question en déclarant qu’un un humain, pour être réellement vertueux, doit respecter la nature. C’est-à-dire, il doit traiter les êtres vivants selon leur valeur intrinsèque.
Un parallèle peut ici être fait avec la théorie de la moralité de Kant. En effet, Kant soutient que l’action morale doit préserver « l’idée » de la personne humaine libre. En d’autres termes, il ne faut pas s’utiliser ou utiliser l’autre comme moyen, car l’humain est une fin à réaliser et non un moyen à utiliser (Kant 1990). Il est à croire que Rolston avait pensé de la même façon à notre contact avec la nature : il ne faut pas traiter la nature comme un moyen, mais plutôt comme une fin. Ou, plus précisément,il faudrait éviter de concevoir la nature uniquement comme une ressource pour ne pas faire d’elle un moyen utilisé insensiblement pour servir nos fins.
Donc, si l’on fusionne les théories de Rolston et de Kant, on pourrait dire que la responsabilité de l’humain est d’agir par devoir à l’égard des écosystèmes, en considérant en tout premier lieu la valeur intrinsèque des organismes qui composent ces derniers. L’être humain qui se trouverait face à un non-humain devrait garder en tête que cet autre a lui aussi, avant tout, une fin en soi avant de poser quelque jugement critique que ce soit à son égard, c’est-à-dire, avant de sauter tout de suite à la conclusion que l’autre est une ressource destinée à répondre aux besoins humains. C’est aussi une façon de dire qu’il n’y a pas de jugement critique universel, valable pour tout être vivant, à part celui de son importance intrinsèque.
Finalement, sachant que plusieurs types de valeurs existent dans la pensée humaine, il est naturel pour notre espèce d’effectuer des jugements à l’égard des vivants qui se partagent le monde. Cependant, selon Rolston, il n’est pas moral d’agir de la sorte, puisque les organismes qui nous entourent ont déjà une valeur qui leur est propre. Ainsi, une telle approche envers les organismes nous mènerait à réfléchir à notre rapport aux écosystèmes qu’ils composent. Même si cet ensemble peut sembler à prime abord flou et désorganisé, c’est la combinaison des êtres qui le composent qui lui donne son essence. Si nous concevons tous les êtres de ce tout, certes imposant, comme nous considérons un meilleur ami chez qui nous reconnaissons cette valeur intrinsèque, pourrions-nous retrouver l’harmonie que nous entretenions avec la nature à l’époque des forêts immenses qui peuplaient cette terre que nous habitons ?