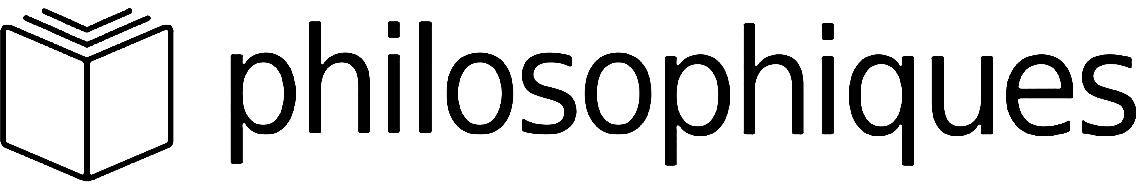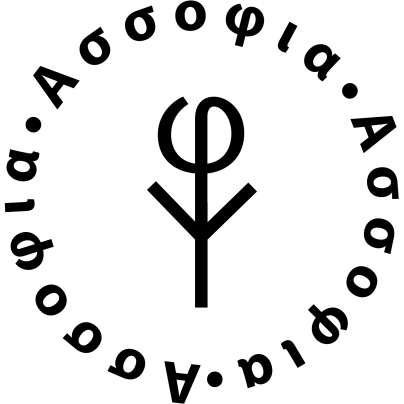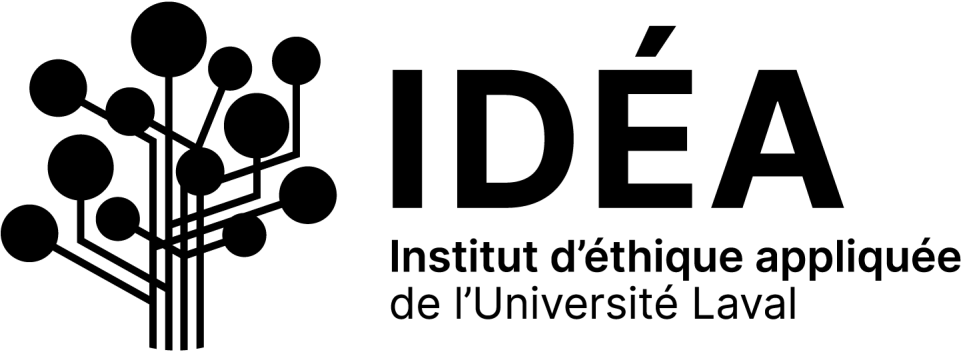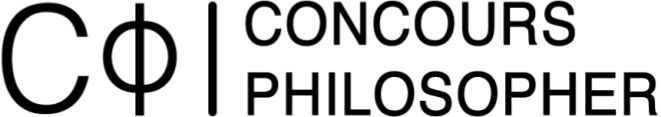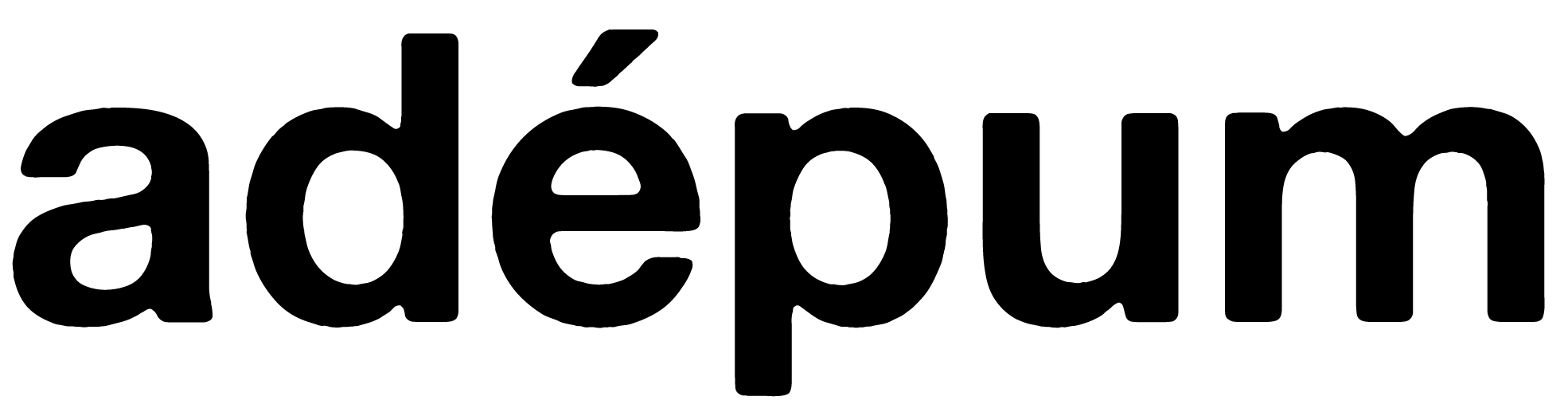No. 03 — Philosophie et environnement
Les écosystèmes peuvent-ils être en bonne santé ou malades ?
Antoine C. DussaultDate de publication: 2025-07-01
Résumé
Dans le discours environnemental et les travaux d'écologie scientifique, on trouve parfois le concept de santé appliqué aux écosystèmes, les pratiques humaines se trouvant évaluées quant à leur impact sur la « santé écosystémique ». Cet article examine une objection courante à ce dernier concept, selon laquelle celui-ci serait au mieux métaphorique parce que l'usage littéral du concept de santé se restreint aux organismes. En m'appuyant entre autres sur l'analyse des conditions d'applicabilité du concept de santé à une entité proposée par la philosophe de l'environnement Katie McShane (2004), je mettrai en évidence que le principal enjeu posé par le concept de santé écosystémique est celui de la normativité qui lui est constitutive.
Mots-clés: érudite, santé écosystémique, environnement, écosystème, santé, normativité, Katie McShane
Télécharger en PDF
Introduction
Dans le discours environnemental et les travaux d’écologie scientifique, on trouve parfois le concept de santé appliqué aux écosystèmes : certaines pratiques humaines sont qualifiées de nuisibles à la « santé de l’écosystème », tandis que d’autres sont décrites comme compatibles avec elle. Cette notion de « santé de l’écosystème », ou de « santé écosystémique », comme je la désignerai dans ce qui suit, a été au centre de plusieurs travaux d’écologie appliquée dans les années 1990 (ex. Costanza, Norton, et Haskell 1992; Rapport et al. 1998) et a suscité, au même moment, un certain intérêt en éthique de l’environnement (Callicott 1990, 1992, 2010; Norton 1991, 1992). Elle semble toutefois avoir ensuite perdu son élan, d’autres concepts comme ceux de biodiversité et de services écosystémiques ayant pris le devant de la scène dans le discours environnemental et écologique1.
Une raison de cette perte de vitesse est la suspicion qu’a éveillée, chez plusieurs écologues et philosophes de l’environnement, l’idée d’appliquer le concept de santé aux écosystèmes. Selon ces écologues et philosophes, le concept de santé ne peut s’appliquer de manière littérale qu’aux organismes, de sorte que l’idée de santé écosystémique ne pourrait, au mieux, qu’être une métaphore. Il s’ensuivrait, semble-t-il, que les écosystèmes ne peuvent pas véritablement être en bonne santé ou malades, ce qui ferait de la préservation de leur « santé » un objectif vain (Hammond et Holland 1995, 285; Nelson 1995, 316; Varner 1998, 17). De surcroît, décrire un écosystème comme en bonne ou en mauvaise santé consisterait possiblement à couvrir trompeusement d’un vernis de scientificité l’expression de préférences personnelles à propos de l’état des écosystèmes (Lackey 1996, 66; Jamieson 1995, 335; Jax 2010, 160‑61)2.
En arrière-plan de cette suspicion, se trouve évidemment la crainte de raviver la vieille controverse ayant marqué les débuts de l’écologie, autour de la question de savoir si les communautés et les écosystèmes peuvent légitimement être considérés comme des organismes d’ordre supérieur, ou des superorganismes. Courante dans les travaux d’écologues de la première moitié du XXe siècle (ex. Clements 1916; Allee et al. 1949), cette conception fait aujourd’hui l’objet d’un discrédit quasi unanime dans l’écologie scientifique 3. Dans l’optique où le concept de santé ne s’appliquerait qu’aux organismes, le concept de santé écosystémique semblerait renouer avec une écologie dépassée, de sorte qu’il vaudrait mieux, pour cette raison, le rejeter (cf. Ehrenfeld 1992, 136‑37; Suter 1993, 1533‑34; Jax 2010, 75, 78).
Le présent article vise à évaluer la force de cette objection. Je tenterai de déterminer s’il existe de bonnes raisons de considérer le concept de santé comme applicable de manière littérale exclusivement aux organismes. Je distinguerai deux types de justifications pouvant être données à une telle restriction : la justification sémantique et la justification théorique. Comme la première justification semble pouvoir être écartée assez aisément (pour des raisons que j’exposerai ci-dessous), je centrerai mon attention sur la seconde. Je l’examinerai en m’appuyant entre autres sur l’analyse des conditions d’applicabilité du concept de santé proposée par la philosophe de l’environnement Katie McShane (2004). Ceci me conduira à mettre en évidence que le principal enjeu posé par l’application du concept de santé aux écosystèmes est celui de la normativité constitutive de ce concept. L’enjeu, en d’autres termes, est celui de la possibilité de fonder une norme de fonctionnement pour les écosystèmes.
Les justifications sémantique et théorique
Pourquoi devrait-on considérer l’usage littéral du concept de santé comme réservé aux organismes ? On trouve, dans les discussions du concept de santé écosystémique, deux types de réponse à cette question : la justification sémantique et la justification théorique.
La première justification est la plus courante. Elle avance simplement que le sens du terme « santé » en restreint l’usage littéral aux organismes. Par définition, ce terme en serait un qui ne s’applique qu’aux organismes. L’écologue Glenn W. Suter, par exemple, affirme : « [p]uisque la santé est une propriété s’appliquant aux organismes, la “santé écosystémique” implique que les écosystèmes sont des organismes » (1993, 1533; voir aussi p. ex. Callicott 1995, 348; Jax 2010, 75). Mais quelle raison aurait-on de considérer le sens du terme « santé » comme en limitant l’usage littéral aux organismes ? Une raison possible serait le fait que, dans son usage vernaculaire, le terme « santé » a toujours été réservé aux organismes. On pourrait alors interpréter cette exclusivité historique comme fixant les limites sémantiques du concept qu’il désigne. Une telle raison m’apparaît toutefois peu convaincante. Elle semble récusée par l’observation que l’on peut couramment faire du caractère évolutif des concepts (tant dans le discours scientifique que dans le langage ordinaire). Par exemple, les usages vernaculaires « ciel » et « horizon » ont longtemps été cantonnés à la perspective de la Terre. Le ciel et l’horizon dont on parle sont généralement le ciel et l’horizon terrestres, ceux qu’on perçoit lorsqu’on observe le monde depuis la perspective terrestre. Les photographies prises lors du premier voyage d’êtres humains sur la Lune ont toutefois rendu évidente la possibilité de parler de « ciel lunaire » et « d’horizon lunaire ». Ces usages de « ciel » et d’« horizon », bien que divergeant de leurs usages historiques, ne semblent pas, de ce simple fait, forcément métaphoriques. Ils se présentent plutôt comme des extensions du champ d’application littéral de ces concepts. La justification sémantique repose, semble-t-il, sur une conception trop fixiste des concepts. Je me permets donc de l’écarter.
Le second type de justification, la justification théorique, est plus prometteuse. Il consiste à identifier des conditions générales d’applicabilité pour le concept de santé et à soutenir que seuls les organismes se trouvent, en pratique, à les remplir. Contrairement à la justification sémantique, la justification théorique laisse de prime abord ouverte la possibilité que des entités autres que les organismes soient de nature à se voir appliquer le concept de santé. Elle soutient néanmoins que le concept de santé se restreint aux organismes pour des raisons théoriques, c’est-à-dire des raisons qui relèvent de ce que constitue la santé. On trouve des (tentatives de) justifications de ce type chez plusieurs critiques du concept de santé écosystémique (ex. Calow 1992, 1‑2; Wicklum et Davies 1995, 997‑98; Ehrenfeld 1992, 140‑41)4.
Un bon point de départ pour évaluer les chances de succès d’une justification de ce type est selon moi l’analyse des conditions d’applicabilité du concept de santé proposée par McShane (2004).
L’analyse de McShane
L’approche de McShane consiste à expliciter ce que l’on signifie généralement lorsqu’on affirme qu’une entité est en bonne santé ou malade, puis à en dégager des conditions d’applicabilité du concept de santé. Selon McShane :
Dire qu’une chose est en bonne santé, c’est dire qu’elle se porte bien, qu’elle prospère. Son état de santé est parfait lorsque toutes ses parties indispensables sont en bon état de fonctionnement et que ses processus vitaux s’accomplissent correctement, ou sont capables de le faire lorsque la situation le requiert. En outre, lorsqu’une chose est en bonne santé, elle est, en ce point, en meilleure posture qu’elle ne le serait si elle n’était pas en bonne santé. Cette description permet de dégager trois conditions pour qu’une chose puisse se voir appliquer le concept de santé : elle doit avoir (1) une structure, (2) des parties ayant des fonctions, et (3) la capacité de se porter mieux ou moins bien (McShane 2004, 230).
Je laisserai de côté la première condition énoncée par McShane, soit celle de la structure. McShane ne développe pas beaucoup sur elle et elle semble beaucoup moins centrale au concept de santé que les deux autres. À propos de la seconde condition, celle des fonctions, McShane précise que, pour qu’une entité soit en bonne santé, il n’est pas requis que ses parties remplissent toutes les fonctions susceptibles de leur être attribuées. Par exemple, on pourrait, dans la mesure où les producteurs de lait élèvent des vaches laitières en partie afin de gagner de l’argent, considérer la génération de profit comme une fonction de la lactation des vaches laitières. Il paraîtrait toutefois peu plausible d’affirmer qu’une vache dont la lactation échoue à générer du profit en raison de conditions économiques défavorables est, pour cette seule raison, malade (McShane 2004, 231‑32). Selon toute vraisemblance, ce qui est requis pour qu’une entité soit en bonne santé est que ses parties remplissent seulement certaines des fonctions susceptibles de leur être attribuées. C’est, selon McShane, la troisième condition qu’elle énonce, à savoir celle de la possibilité pour l’entité d’aller mieux ou moins bien ou, en termes plus techniques, de la normativité, qui permet de distinguer les fonctions dont l’accomplissement est nécessaire à la santé d’une entité de celles dont l’accomplissement ne l’est pas. Ainsi, sa proposition est qu’une entité est en bonne santé lorsque ses parties accomplissent les fonctions qui lui permettent de se porter bien, et la condition de normativité agit comme clé de voûte de son analyse.
Élaguée de sa première condition et légèrement reformulée, l’analyse de McShane suggère qu’une entité peut se voir appliquer le concept de santé dans la mesure où (1) elle est fonctionnellement organisée, c’est-à-dire formée de parties qui y remplissent des fonctions, et (2) elle est de nature à pouvoir fonctionner mieux ou moins bien ou, en d’autres termes, il possible d’établir pour elle une norme de fonctionnement5. Les organismes semblent assez clairement remplir ces deux conditions. Ils sont des cas paradigmatiques d’entités fonctionnellement organisées. Les manuels de biologie sont truffés de références aux fonctions de l’une ou l’autre de leurs parties. Par ailleurs, ils paraissent pouvoir fonctionner mieux ou moins bien. Par exemple, une plante qui, sous l’effet d’un parasite, devient inapte à accomplir la photosynthèse, fonctionne moins bien qu’une plante qui y est apte—et il est, de surcroît, plausible de considérer la plante comme, de ce fait, malade. Déterminer l’applicabilité du concept de santé aux écosystèmes requerrait donc de déterminer s’ils remplissent aussi ces conditions.
Avant de le faire, il est toutefois nécessaire de considérer une limite potentielle de l’analyse de McShane pour ensuite la bonifier. La limite est qu’en l’état, cette analyse rend le concept de santé (inopportunément) applicable aux artéfacts, c’est-à-dire aux objets produits par les humains (ou d’autres animaux) en vue de certains usages. Ceux-ci pourraient donc non-métaphoriquement être en bonne santé ou malades. Un vélo, par exemple, est formé de parties y accomplissant des fonctions. Il est un assemblage de pièces (le guidon, la chaine, le dérailleur, etc.) dont chacune remplit une fonction particulière relativement à son fonctionnement global. Un vélo peut aussi fonctionner mieux ou moins bien. Un vélo dont la chaine est rouillée et tourne, de ce fait, plus laborieusement fonctionne moins bien qu’un vélo dont la chaine est neuve. Néanmoins, l’affirmation voulant qu’un vélo soit en bonne santé ou malade semble métaphorique. Il en va de même pour la plupart des artéfacts, par exemple les réfrigérateurs, les systèmes de chauffage ou les ascenseurs. Ceci suggère la nécessité d’ajouter (au moins) une condition à celles énoncées par McShane, afin d’exclure les artéfacts de la classe des entités pouvant faire l’objet d’un usage littéral du concept de santé.
Un aspect souvent présenté comme distinguant les organismes (auxquels on peut supposer que s’applique le concept de santé) des artéfacts semble pouvoir remplir ce rôle. Une caractéristique distinctive des organismes est qu’ils constituent des entités auto-maintenues, c’est-à-dire des entités dont le maintien dans l’existence dépend de l’accomplissement des fonctions de leurs parties (voir p. ex. McLaughlin 2001, part. III; Nicholson 2013; Holm 2017). Par exemple, une plante ne peut continuer d’exister qu’à condition que ses racines puisent adéquatement dans le sol les nutriments dont elle a besoin, que ses feuilles accomplissent adéquatement la photosynthèse, que ses xylèmes et phloèmes acheminent adéquatement sa sève, etc. Les artéfacts ne présentent généralement pas cette caractéristique. Un vélo laissé à l’abandon dans une remise de sorte que ses parties n’ont pas l’occasion d’accomplir leurs fonctions ne s’usera pas forcément plus rapidement qu’un vélo fréquemment utilisé. Le maintien dans l’existence du vélo ne dépend pas de l’accomplissement des fonctions de ses parties.
Cette différence explique selon moi pourquoi le concept de santé ne semble pas applicable de manière littérale aux artéfacts. Ainsi, l’analyse de McShane devrait être bonifiée par l’ajout d’une condition d’auto-maintien : une entité peut se voir appliquer de manière littérale le concept de santé dans la mesure où (3) elle se maintient dans l’existence par l’accomplissement des fonctions de ses parties6.
Application aux écosystèmes
Comme le note McShane, les écosystèmes remplissent à première vue la condition de présenter une forme d’organisation fonctionnelle (McShane 2004, 238‑39). Par exemple, les plantes impliquées dans un écosystème y remplissent la fonction de capter l’énergie solaire par photosynthèse et de la rendre disponible aux autres organismes, certains champignons et bactéries y remplissent la fonction de fixer l’azote, certains animaux y remplissent la fonction de réguler la croissance des populations affectées par leurs activités de prédation, d’herbivorie, ou de parasitisme. L’idée selon laquelle les organismes impliqués dans les écosystèmes y remplissent des fonctions est courante en écologie et a fait l’objet de quelques discussions en philosophie de l’écologie (voir p. ex. Odenbaugh 2010, sect. 3; Nunes-Neto, Moreno, et El-Hani 2014; Dussault 2018).
Les écosystèmes semblent aussi remplir la condition d’auto-maintien. Comme les organismes, ils se maintiennent par l’accomplissement des fonctions de leurs parties. Ils se maintiennent dans l’existence parce que, par exemple, les plantes qui les composent captent l’énergie solaire et la rendent disponible aux autres organismes, certains champignons et bactéries fixent l’azote, etc. Si toutes les plantes impliquées dans un écosystème devenaient soudainement incapables d’accomplir la photosynthèse, l’écosystème cesserait d’exister7.
Qu’en est-il de la condition de normativité, c’est-à-dire celle de la possibilité d’établir une norme de fonctionnement pour les écosystèmes ? Il s’agit de la condition posant le défi le plus sérieux, et il ne sera pas possible ici de déterminer de manière définitive si les écosystèmes peuvent la remplir. Le faire requerrait de statuer sur la question de savoir ce qu’est la bonne manière de rendre compte de la normativité constitutive du concept de santé, une question faisant l’objet d’un vaste débat en philosophie de la médecine, au sein duquel plusieurs manières de concevoir cette normativité ont été proposées et opposées les unes aux autres (pour des tours d’horizon, voir Giroux 2010; Murphy 2015; Pellet 2018). Il est raisonnable de s’attendre à ce que certaines de ces conceptions rendent le concept de santé applicable seulement aux organismes, alors que d’autres se prêtent à une application plus large.
Par exemple, une conception influente, proposée par le philosophe de la médecine Jerome Wakefield (2012), adopte une norme de fonctionnement fondée sur la sélection naturelle passée (qui s’aligne, à cet égard, avec la théorie étiologique-sélective de la fonction défendue par de nombreux philosophes de la biologie, voir p. ex. Neander 2009). Elle adopte comme condition pour qu’une entité soit malade le fait que certaines de ses parties ne fonctionnent pas comme la sélection naturelle les a destinées à fonctionner. Une telle condition restreint le champ d’application du concept de santé aux entités sujettes de manière unifiée à la sélection naturelle, c’est-à-dire qui sont des « niveaux de sélection ». Ceci rend, au bout du compte, le concept de santé inapplicable aux écosystèmes, puisque selon ce qu’indique la recherche actuelle en écologie, sauf dans de rares cas, ils ne sont pas des niveaux de sélection (voir Odenbaugh 2010, sect. 4).
D’autres conceptions de la santé ne compromettent toutefois pas aussi catégoriquement l’applicabilité du concept de santé aux écosystèmes. C’est le cas, par exemple, de la conception défendue par les philosophes de la biologie de Cristian Saborido et Alvaro Moreno (2015), qui adopte une norme de fonctionnement liée à la capacité d’auto-maintien d’une entité (au sens discuté ci-dessus, mais avec l’ajout de certaines subtilités). Une publication récente soutient d’ailleurs l’applicabilité de cette conception à certains écosystèmes (Sfara et El-Hani 2023).
Les conceptions de Wakefield et de Saborido et Moreno ne sont que deux conceptions parmi plusieurs autres ayant été proposées en philosophie de la médecine et à partir desquelles pourrait être évaluée la possibilité de formuler une norme de fonctionnement pour les écosystèmes. Au regard de la question de l’applicabilité du concept de santé aux écosystèmes, la condition de la normativité est donc celle qui est déterminante. L’enjeu posé par la normativité constitutive du concept de santé est, par conséquent, celui sur lequel devraient se concentrer les examens philosophiques futurs du concept de santé écosystémique. Enfin, ces discussions gagneraient à s’appuyer sur celles menées en philosophie de la médecine sur le même enjeu8.
Bibliographie
Comme le relève Kurt Jax (2010, 154, 157), des trois revues fondées dans les années 1990 dont le titre contenait l’expression « santé écosystémique » (Ecosystem Health, Journal of Aquatic Ecosystem Health, et Aquatic Ecosystem Health & Management), une seule existe encore aujourd’hui.↩︎
Pour une discussion plus détaillée de cet enjeu de la métaphoricité et de certaines tentatives de minimiser les problèmes qu’il soulève, voir Antoine C. Dussault (2021, sect. 2.2)↩︎
Pour plus de détails sur cette page de l’histoire de l’écologie, voir par exemple, McIntosh (1998) et Bergandi (1999).↩︎
Pour une discussion de leurs arguments, voir Dussault (2021, sect. 2.3).↩︎
Mon interprétation de la condition de normativité en termes de « norme de fonctionnement » dévie quelque peu de celle adoptée par McShane. McShane en propose une interprétation reprenant la théorie du bien-être (welfare) en termes de souci rationnel (rational care) introduite par l’éthicien Stephen Darwall (2002).↩︎
Évidemment, cette condition admet que d’éventuels artéfacts auto-maintenus pourraient être en bonne santé ou malades. Cette implication ne me semble pas d’emblée rebutante.↩︎
Sur ce point, voir le lien fait par Callicott (Callicott 1992, 50‑52) entre le concept de « land health » introduit par Aldo Leopold et celui d’autopoïèse (Maturana et Varela 1980).↩︎
La préparation de cet article a bénéficié du soutien financier du Fonds de recherche du Québec – Société et Culture (FRQSC, 2024-PEC-335614)↩︎