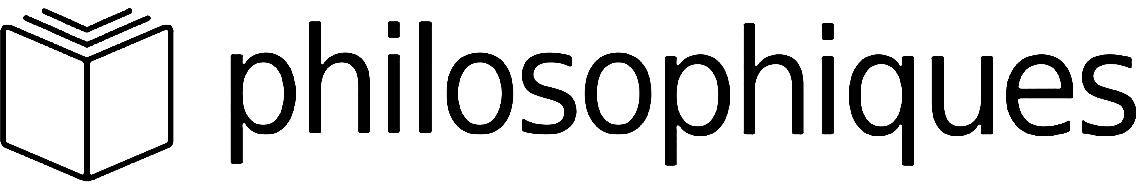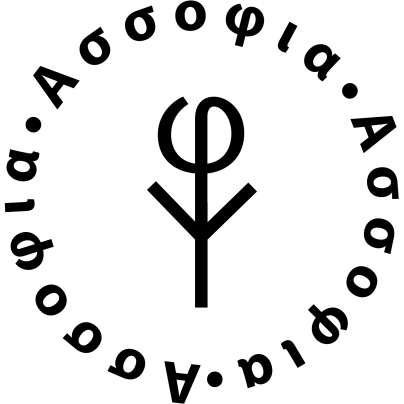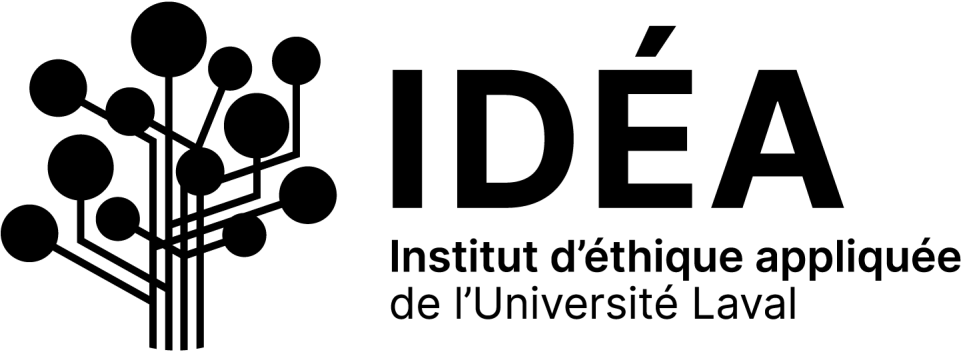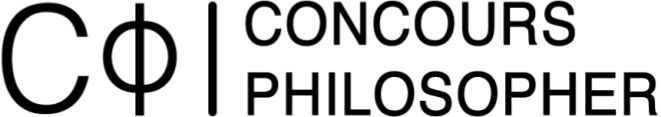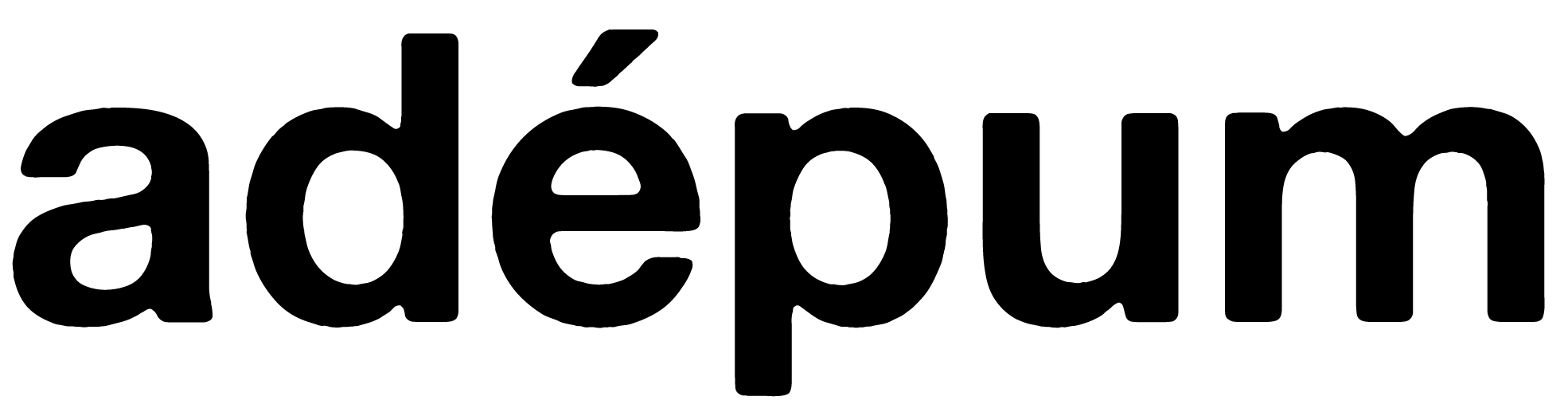No. 03 — Philosophie et environnement
Tisser les mots, Tisser les mondes: le rôle du tissage dans la réconciliation de l’humain avec son environnement
Chloé Gonzalez, École supérieure d'art et de design TALM-AngersLoune Hausherr, École supérieure d'art et de design TALM-Angers
Date de publication: 2025-07-01
Résumé
Cette étude interroge la question environnementale en examinant l’Homme dans son territoire, son habitat et sa cohabitation avec celui-ci. Notre raisonnement s'ancre dans la relation humaine à la cueillette, première interaction avec la nature et récit inexploité. Cette analyse souligne la technique du tissage, premier outil artisanal : entrelacement de fils pour créer un tissu, et symbole de notre relation avec l'environnement en délimitant un espace clos qui unit le corps et le dehors. L’objectif est de repenser notre place dans l’environnement, en privilégiant le récit du cueilleur au héros chasseur, ouvrant ainsi d’autres perspectives via la fiction, le travail d’artistes et de philosophes.
Mots-clés: créative, cueillette, tissage, narration, territoire, coexistence
Télécharger en PDF
Cette étude interroge la question environnementale à travers la philosophie et l’art, qui influencent nos modes de pensée et les enjeux sociétaux. Elle explore la relation de l’humain à son territoire, à l’habitat et à la cueillette, première interaction avec la nature. Le tissage, pratique ancestrale et vecteur de transmission, sert ici de point central : qu’il s’agisse de fils ou de récits, il a toujours accompagné l’humanité pour se vêtir, se loger et se raconter. Repenser sa place aujourd’hui pourrait transformer notre façon de vivre dans le monde.
Notre réflexion s’appuie sur Gilles Deleuze (1980) et Ursula K. Le Guin (2018) pour repenser notre place dans le monde. Elle propose de s’éloigner du récit héroïque du chasseur au profit du cueilleur, dont le rapport à l’environnement s’inscrit dans une collecte mesurée et un mouvement nomade. L’objectif est d’élargir les questionnements écologiques au-delà d’une perspective occidentalo-centrée, en intégrant la fiction, ainsi que les approches d’artistes et de philosophes souvent marginalisé·es.
Lorsqu’on pense à l’environnement, on l’associe à notre cadre de vie quotidien, devenu confortable grâce aux adaptations humaines. Les vêtements ont joué un rôle clé dans cette évolution, nous permettant de nous affranchir des variations climatiques. Le tissu, issu du tissage, repose sur l’entrecroisement de fils pour former une étoffe, d’abord en fibres végétales, puis en matières synthétiques avec l’industrialisation. La technique, remontant à la préhistoire, consiste à tendre des fils verticaux (« la chaîne ») et à les entrelacer avec des fils horizontaux (« la trame »), qui varient selon le motif. Ainsi, les ressources naturelles ont façonné cette pratique avant d’être peu à peu remplacées par des matériaux plastiques non recyclables, conséquence des avancées technologiques et de la société de consommation. Cette progression et transition de technique nous pousse à analyser l’action de tisser pour comprendre son impact sur notre perception de notre environnement.
Selon le philosophe français Gilles Deleuze dans son ouvrage Mille Plateaux, nous pouvons concevoir le tissu et cet entrecroisement de fils comme une métaphore de notre rapport humain/habitat. Deleuze nous parle de l’étoffe comme d’un ensemble d’éléments mobiles passant en dessous et au-dessus des éléments fixes (trame sur chaîne). Ce qu’il nous décrit ici c’est de percevoir le tissage comme un « solide souple ». Cette nouvelle conception nous montre alors le tissu comme un espace fermé contenant des aller-retours en lui. Ainsi, le tissu – et donc par extension le vêtement que nous portons au quotidien – est un espace fermé sur notre corps. Gilles Deleuze l’exprime dans ce passage en parlant du strié : « le tissu-vêtement et le tissu-tapisserie tendent à annexer tantôt le corps, tantôt l’espace extérieur, à la maison immobile : le tissu intègre le corps et le dehors à un espace clos. » (Deleuze et Guattari 1980, 594). Au cours de notre évolution, on a délimité l’extérieur et l’intérieur en nous sédentarisant. Notre environnement est alors disparu au profit de notre soi et chez soi, ce qui nous détache de l’impact que nous avons sur lui et des transformations que nous y conduisons, au bénéfice de notre confort au XXIe siècle. Mais ne peut-on pas envisager un autre modèle viable qui serait plus en adéquation avec notre environnement ?
Dans cette reconsidération de notre environnement, on peut s’intéresser à un autre procédé de création d’étoffe, autre que le tissage. Deleuze aborde aussi le lisse en s’intéressant à la feutrine. Cette technique consiste à brosser des fibres végétales, animales ou chimiques jusqu’à l’obtention d’un ensemble plus ou moins lisse. Ce procédé devient alors une sorte d’anti-tissu. « Il n’implique aucun dégagement des fils, aucun entrecroisement, mais seulement un enchevêtrement des fibres, obtenu par foulage. Un tel ensemble d’intrication n’est nullement homogène (contrairement au tissage, cet espace fermé) : il est pourtant lisse, et s’oppose point par point à l’espace du tissu » (Deleuze et Guattari 1980, 594). Cette feutrine est très employée chez les populations nomades, comme les mongoles, qui l’utilisent dans leurs yourtes pour en faire leurs parois. Ce modèle est différent de la sédentarisation, ne serait-ce que par l’essence même de la technique de création, mais sert pourtant la même fonction : isoler et protéger de l’extérieur. Cette conception d’un habitat déplaçable et à assembler rend la perception de l’environnement complètement différente :« Ainsi, le nomadisme comme mode de vie en tissant indexe le vêtement et la maison même sur l’espace du dehors, sur l’espace lisse ouvert où le corps se meut. » (Deleuze et Guattari 1980, 594). Au lieu d’une maison fixe, nous pourrions envisager la yourte comme modèle de vie, comme un espace qui s’organise sans sectarisation et dans le communautarisme.
Dans cette nouvelle proposition de vivre avec son environnement, l’étude de l’organisation de vie en groupe est toute aussi importante. Le lien entre tissage et corps qui se mue dans son environnement est encore possible, comme le montre le Bauhaus avec leur département de tissage. Des artistes telles que Annie Albers ou Dörte Helm et bien d’autres se sont construites dans un contexte de Seconde Guerre mondiale et de patriarcat ont réussi, par le tissage – seul département accessible pour elles alors que c’était la première année d’ouverture aux femmes en 1930 – à créer un mouvement d’émancipation à l’encontre de la décision de Walter Gropius, directeur à cette époque. Les femmes n’avaient malheureusement pas été pensées dans ce modèle. Dans ce système misogyne, les femmes étaient reléguées à la cuisine et au potager pour nourrir les hommes de l’école et cultiver les fibres organiques destinées au tissage, sous prétexte de leur genre et de leur lien avec le textile. Ce dernier repose souvent sur l’usage de fibres naturelles, qu’il s’agisse de filage, de teinture ou de fabrication de bobines. Face à cette domination, les femmes du Bauhaus ont tenté d’inverser la dynamique en développant un modèle d’autosuffisance fondé sur la solidarité, la communication et la culture agricole.
Pour pouvoir repenser notre vision sociale en communauté et notre rapport à l’environnement, il est possible que nous devions revoir les narrations qui bâtissent notre société. Nous avons choisi de nous pencher sur le travail de Ursula K. Le Guin. Dans La Théorie de la Fiction Panier (2018), l’autrice interroge tout d’abord l’écriture du genre littéraire de la Science-fiction, tout en questionnant aussi des principes sociétaux plus larges. Elle propose que les récits ne soient plus basés sur ce qu’elle appelle le récit « lance » : l’éternelle histoire du chasseur qui cherche à tuer la proie, tel qu’on imagine les récits primitifs. Ainsi, sa proposition est que la composition de la narration ne serait plus entièrement basée sur le conflit. Dans son travail, l’idée est de raconter une histoire qui contient des choses telles un contenant, comme en son sens original : le récipient dans lequel on vient déposer le fruit de notre cueillette, en opposition à la lance qui empale.
« L’important, c’est de comprendre avec qui tu tisses, pourquoi les objets ont une signification, à quoi servait l’objet que tu confectionnes, comment l’utiliser correctement. Ça implique bien plus que le simple fait de tisser. » (Johnson s. d., 02:17‑34). Le Guin s’appuie sur les carnets préparatoires de Virginia Woolf pour Trois Guinées (2012), où cette dernière invente un glossaire : le « bouteillisme » y remplace l’« héroïsme », valorisant la capacité d’être un contenant, une « bouteille », c’est-à-dire l’accueil, la collecte et la transmission plutôt que l’action conquérante du héros traditionnel. Ces carnets n’ont jamais été publiés. Le héros devient ainsi bouteille. C’est ainsi que U.K. Le Guin rejoint son propos en imaginant que la bouteille devient le héros. Tout d’abord, il y a la destitution du héros, comme pour le bouteillisme. Il n’est plus au centre du récit. Le sac, tout comme la bouteille, est la forme que prendra la narration afin de créer une narration plus globale et moins excluante. Ce sac est tissé de différents brins, associés les uns aux autres et forment ensemble un tissu, qui permettra de contenir la narration en son sein.
« Ce qui est vraiment important dans ce que nous appelons le tissage, c’est le savoir culturel contenu dans les objets – savoir quelles plantes cueillir, à quelle période de l’année, et aussi ce qui est disponible à la récolte afin de manger d’une manière véritablement durable. » (Johnson s. d., 01:33‑59). Dans « La science fiction et l’avenir » (2020, 171‑72), Le Guin parle du concept du futur comme avancée et le questionne. Dans cet article, l’autrice se base sur les façons de penser des peuples des Andes et particulièrement sur la langue quechua dans laquelle le futur ne consiste pas à aller vers l’avant. L’idée est plutôt de regarder derrière nous, par-dessus son épaule. Cela a pour conséquence, dans cette façon de penser, de poser le futur comme quelque chose que l’on ne peut voir depuis le présent. Cette manière de percevoir peut nous permettre de nous concentrer sur le moment présent, sans faire trop de supposition sur le futur, ce qui s’ancre en opposition avec le travail habituel de la science-fiction.
La science-fiction, selon Le Guin, ne se base pas sur les progrès scientifiques et technologiques de l’humain. Elle compare ce progrès a une flèche qui emporte l’humanité vers le futur. C’est une flèche qui tue, tout comme la lance. La science-fiction de Le Guin replace l’anthropologie au centre du récit, l’évolution des peuples avant l’évolution des sciences. Elle écrit « Ce qui fait la différence ce ne fut pas la viande, mais le récit » (Le Guin 2020). Les progrès technologiques ne sont pas toujours synonymes de progrès sociaux. De plus, dans la question environnementale, nos progrès scientifiques, même si présents dans les technologies vertes, ne permettent pas réellement de résoudre le problème environnemental. Créer de nouvelles technologies pour pallier la surconsommation ne résout rien sans une remise en question de nos modes de vie. Contrairement aux technologies vertes et au greenwashing, la Fiction Panier propose de placer la cueillette comme action centrale de la narration et valorise la cueillette comme alternative à la domination et à l’exploitation des ressources. Il n’est plus question de se battre, de conquérir, de dominer ou de rentabiliser les choses. Il est question de venir récolter les biens déjà existants. Cette pensée s’articule en opposition à l’agriculture intensive. Plutôt que de transformer la nature pour répondre aux besoins du marché, elle invite à récolter l’existant, ouvrant la voie à des modes de consommation plus respectueux, tant pour l’agriculture que pour les relations humaines.
Notre approche se tourne vers la coexistence avec notre environnement plus que vers la domination d’un territoire ou d’un peuple par un autre. Dans cette période de crise et d’urgence climatique, il est important de s’éloigner de la vision colonialiste de l’exploration et de la conquête des mondes. La vision de la société et du monde de la Fiction Panier offre bien plus de possibilités et touche à de nombreuses notions. Le concept du Conflit, par exemple, peut être réinventé, voire totalement disparaître au sein de la Fiction Panier. Puisque les narrations ne consistent plus à raconter des batailles, des guerres et des meurtres, cela laisse de la place à des nouvelles histoires et façons de penser. Il peut y avoir la création de solutions alternatives à la violence dans la résolution de conflits. La paix et les modes d’action plus pacifistes sont imaginées, et la création de ces nouvelles possibilités peuvent engendrer des actions concrètes à l’extérieur de la fiction.
La technique même du tissage résonne avec des problématiques de relations avec autrui et notre environnement. Le temps de créer et ce travail avec les fils interrogent les utilisations de matériaux et amènent à questionner la notion de cohabitation. L’artiste Marie-Claire Messouma Manlanbien illustre cette réflexion en mêlant matières naturelles et industrielles, questionnant ainsi leur coexistence. Elle confie que « c’est la relation que l’on entretient avec tout ce qui nous entoure et la manière dont on se positionne dans notre environnement. Il s’agit aussi de questions qui nous concernent tous·tes, par exemple la question écologique et notre place au sein de ce monde dans lequel nous cohabitons avec d’autres formes de vie. J’essaie de donner à voir, de questionner. La cohabitation est-elle possible ? Comment la donner à voir ? Et si elle n’est pas possible, comment donner aussi cela à voir ? » (2023, l. 176) Le tissage ne se limite pas à une technique textile ; il façonne la société en proposant un modèle éco-responsable, détaché des structures dominantes occidentales. Il crée du lien entre individus et territoires, encourage la pleine conscience et valorise une approche collective inspirée des sociétés tributaires. En rythmant les échanges et la vie communautaire, il permet aussi aux générations de se réunir pour transmettre histoires et savoirs culturels.
« Nous faisons tous partie de ce mouvement, disons-nous ; et le cours de la rivière est sacré, ce bouquet d’arbre est sacré, et nous sommes nous-mêmes, disons-nous, sacrées » (Griffin 1978, 186). Griffin propose une vision de la nature où tout est sacré et interconnecté, contrairement à la perception masculine qui cherche à la dominer et à conquérir cette nature dite sauvage (celle qu’ils ne contrôlent pas) comme externe à leur existence. En opposition à cette approche, notre article invite le lecteur à questionner notre rapport sociétal à notre environnement dans un prisme plus féminin, sur l’écoute et le faire ensemble. Nous pouvons finir avec ces quelques mots qui ont été prononcés par Le Guin lors des National Book Awards en 2014 : « Des temps difficiles arrivent, où nous aurons besoin des voix d’écrivains capables d’imaginer des alternatives à notre mode de vie actuel, capables de voir au-delà de notre société dominée par la peur et ses technologies obsessionnelles, vers d’autres façons d’être, et même d’imaginer de véritables raisons d’espérer. Nous aurons besoin d’écrivains qui se souviennent de la liberté – des poètes, des visionnaires – des réalistes d’une réalité plus vaste. […] Nous vivons dans le capitalisme, dont le pouvoir semble inéluctable – mais il en allait de même du droit divin des rois. Tout pouvoir humain peut être contesté et transformé par des êtres humains. La résistance et le changement commencent souvent dans l’art. Très souvent dans notre art, l’art des mots. » (Le Guin 2014, traduction libre)
C’est le rôle des artistes que de proposer ces nouveaux récits au travers de leurs narrations et tissages. Chaque artiste a cette responsabilité de proposer des récits; on peut espérer pouvoir avancer vers les récits-vivants tout en abandonnant les récits-qui-tuent. Créer des narrations ayant une apothéose et non un conflit comme point central et ne plus faire des conflits les seules narrations valables. Ces façons d’écrire peuvent permettre de sortir de la façon traditionnelle de voir l’histoire comme étant seulement celle du combat oppresseur·es/opprimé·es mais d’en faire des versions plus ouvertes, un contenant de pleins de petites histoires sans prévalence sur les autres, toutes imbriquées, créant des mondes. Nous pouvons explorer ces mondes sans violence et avec un regard neuf, afin de collecter dans notre sac toutes les histoires à raconter.