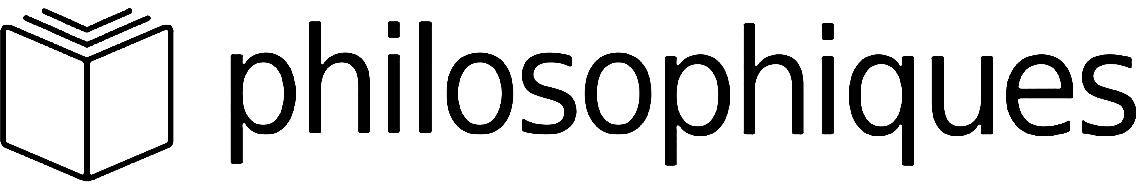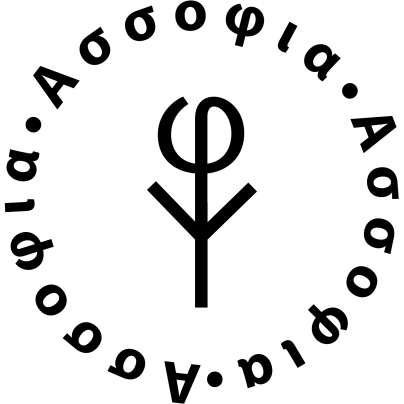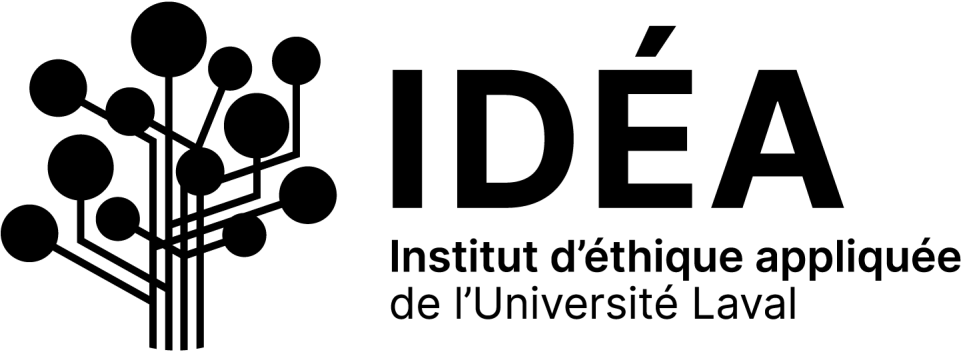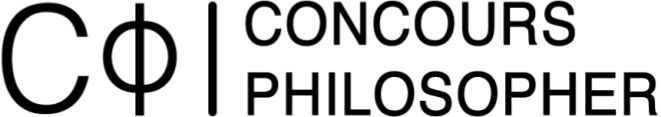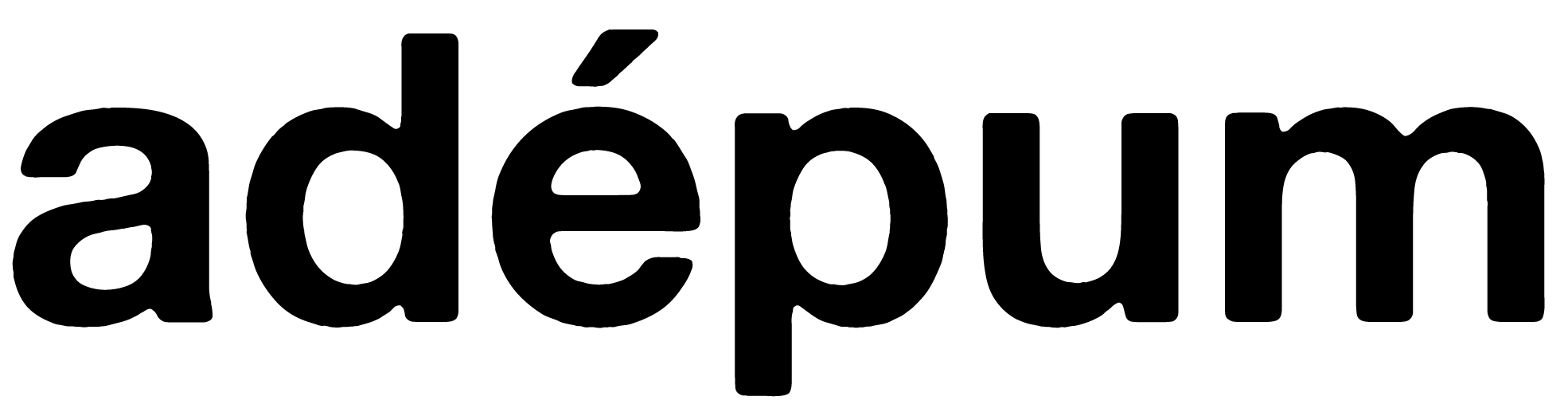No. 03 — Hors-thème
Freire, Paulo. 2021. La pédagogie des opprimé•es, Éditions de la Rue Dorion, Montréal, p.257-267, 274-277, 281-291 (extraits)
Paulo FreireDate de publication: 2025-07-01
Mots-clés: traduction
Télécharger en PDF
La section traduction de la revue vise deux objectifs. Le premier concerne le soucis d’une plus grande accessibilité pour les francophones à des textes philosophiques rédigés dans une langue autre que le français (en faisant aussi un effort pour présenter des traductions de texte dont la langue d’origine n’est pas l’anglais). Le but est d’ouvrir de nouveaux dialogues et de nourrir la pensée au-delà des barrières linguistiques. Le second objectif veut mettre en valeur les maisons d’éditions francophones et leur travail de traduction et de publication, essentiel à la vie philosophique.
Freire, Paulo. 2021. La pédagogie des opprimé•es, Éditions de la Rue Dorion, Montréal, p.257-267, 274-277, 281-291 (extraits).
Paulo Freire (1921-1997) est un philosophe et éducateur brésilien reconnu pour ses écrits sur la pédagogie, qui agit selon lui à titre d’action de libération des peuples opprimés, et non pas comme transmission (du savoir, de la culture, de la connaissance, etc.).
Un mot sur la maison d’édition
Les Éditions de la Rue Dorion proposent une publication diversifiée d’ouvrages originaux, qui s’inscrivent en littérature, en histoire et en théorie critique radicale. La maison d’édition cherche à publier du contenu participant aux efforts révolutionnaires, à la transformation du monde. Les Éditions de la Rue Dorion se spécialisent également dans les traductions d’ouvrages critiques connus – notamment, on leur doit la traduction française de Phénoménologie queer (Sara Ahmed), Capitalisme Carcéral (Jackie Wang), Pour la Palestine comme pour la terre (Andreas Malm), et plus encore.
La théorie de l’action dialogique et ses caractéristiques : la co-opération, l’union, l’organisation et la synthèse culturelle
La co-opération
Si la caractéristique première de la conquête, dans la théorie de l’action anti-dialogique, suppose un sujet qui, en conquérant l’autre, le transforme en « quasi-chose », dans la théorie de l’action dialogique les sujets se retrouvent en co-opération pour transformer le monde.
En effet le je anti-dialogique, dominateur, transforme le tu dominé, conquis, en simple « cela1 ».
À l’inverse, le je dialogique sait que c’est exactement le tu qui le constitue. Il sait aussi que, constitué par un tu – un non-je –, ce tu qui le construit se constitue, à son tour, en je, ayant lui-même en son je un tu. Ainsi, le tu et le je deviennent, dans la dialectique de ces relations constitutives, deux tu qui se changent en deux je.
Il n’y a donc pas, dans la théorie dialogique de l’action, un sujet dominant par la conquête et un objet dominé : il y a des sujets qui se retrouvent pour prononcer le monde, pour le transformer.
Si les masses populaires dominées se croient incapables, à un moment historique donné, d’accomplir leur vocation de sujets, elles pourront le faire en problématisant leur propre oppression, ce qui implique toujours une forme d’action, quelle qu’elle soit.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de place pour les leaders révolutionnaires.
Cela signifie simplement que les leaders, pour important que soit leur rôle – il faut reconnaître qu’il est fondamental et indispensable –, ne sont pas propriétaires des masses populaires.
En effet, l’importance de leur rôle ne leur donne pas le droit de les commander aveuglément pour les libérer. Dans le cas inverse, ces leaders reproduiraient le messianisme salvateur des élites dominatrices, malgré leur intention de vraiment « sauver » les masses populaires.
Mais dans cette hypothèse, la libération ou le « salut » des masses populaires serait un cadeau, un don, ce qui briserait leur relation dialogique et les ferait passer du statut de coauteures de l’action de libération à celui d’objets de cette action.
La co-opération, caractéristique de l’action dialogique qui ne peut avoir lieu qu’entre sujets, bien qu’ils aient des niveaux de fonctions différents, et donc de responsabilités, ne peut se réaliser que dans la communication.
C’est donc le dialogue, qui est toujours communication, qui fonde la co-opération. Dans la théorie de l’action dialogique, il n’y a pas de place pour la conquête des masses, mais bien pour leur adhésion aux idéaux révolutionnaires.
Et le dialogue n’impose pas, ne manipule pas, ne domestique pas, n’use pas de slogans.
Cela ne veut pas dire que la théorie de l’action dialogique conduise au néant. Ni que l’être dialogique cesse d’avoir une conscience claire de ce qu’il veut et des objectifs pour lesquels il s’est engagé.
Les leaders révolutionnaires, engagés envers les masses, ont un engagement envers leur liberté. Et c’est précisément au titre de cet engagement qu’ils ne peuvent chercher à les conquérir, mais qu’ils doivent obtenir leur adhésion pour la libération.
L’adhésion conquise n’est pas une adhésion parce qu’elle est une adhérence de l’être conquis à l’être conquérant à travers les prescriptions du dernier sur le premier.
La véritable adhésion est la libre coïncidence des choix. On ne peut l’observer que dans l’intercommunication des êtres humains, médiatisés par la réalité.
Dès lors, contrairement à ce qui se passe avec la conquête dans la théorie anti-dialogique de l’action, qui mythifie la réalité pour maintenir la domination, dans la co-opération exigée par la théorie dialogique de l’action, les sujets dialogiques se tournent vers la réalité médiatrice qui, problématisée, les met au défi. Et la réponse qu’ils y apportent est déjà une action qu’ils exercent sur elle, pour la transformer.
Problématiser, toutefois, n’est pas employer des slogans, c’est réaliser une analyse critique de la réalité envisagée comme un problème à résoudre.
Alors que dans la théorie anti-dialogique les masses sont des objets sur lesquels s’effectue l’action de conquête, dans la théorie de l’action dialogique elles sont des sujets à qui il incombe de conquérir le monde. Si elles s’aliènent de plus en plus dans le premier cas, dans le second elles transforment le monde pour la liberté des êtres humains.
Alors que dans la théorie de l’action anti- dialogique, l’élite dominatrice mythifie le monde pour mieux le dominer, la théorie dialogique exige de le dévoiler. Dans la mythification du monde et des êtres humains, il y a un sujet qui mythifie et des objets qui sont mythifiés ; à l’inverse, ce qui se passe dans le dévoilement du monde est tout autre : c’est sa démythification.
Ici, à proprement parler, personne ne dévoile le monde à autrui, et même si un sujet lance cet effort de dévoilement aux autres, ceux-ci doivent devenir sujets de cet acte.
Dans la praxis authentique, c’est l’adhésion des masses qui leur permet de dévoiler le monde et de se dévoiler elles-mêmes.
Cette adhésion coïncide avec la confiance grandissante qu’elles ont en elles et dans les leaders révolutionnaires, lorsqu’elles perçoivent leur dévouement et leur authenticité dans la défense de la libération des êtres humains.
La confiance des masses envers les leaders suppose aussi la confiance de ceux-ci envers les masses.
Toutefois, cette confiance en elles ne saurait être naïve.
Les leaders doivent faire confiance aux potentialités des masses, qu’ils ne peuvent traiter comme objets de leur action. Ils doivent avoir confiance en leur capacité à s’engager dans la recherche de leur libération. Mais ils doivent se méfier, toujours se méfier, de l’ambiguïté des opprimé·es.
Se méfier des personnes opprimées ne veut pas dire se méfier d’elles en tant qu’êtres humains, mais se méfier de l’oppresseur « logé » en elles.
Ainsi, lorsque Che Guevara attire l’attention du révolutionnaire sur la nécessité de «se méfier même de son ombre, des paysans amis, des informateurs, des guides, des contacts ; se méfier de tout2 », il n’est pas en opposition avec la condition fondamentale de la théorie de l’action dialogique. Il est juste réaliste.
De fait la confiance, bien qu’étant un préalable au dialogue, n’est pas une donnée a priori de celui-ci : c’est un résultat de la rencontre où les femmes et les hommes deviennent sujets de la dénonciation du monde, pour le transformer.
Ainsi, tant que les êtres opprimés seront moins eux- mêmes que l’oppresseur « à l’intérieur » d’eux, leur peur naturelle de la liberté pourra les conduire à la dénonciation, non de la réalité oppressive, mais des leaders révolutionnaires.
C’est la raison pour laquelle ces leaders ne peuvent se permettre d’être naïfs et doivent être attentifs à ces possibilités.
Dans le récit du Che sur la lutte de la Sierra Maestra, texte qui a pour tonalité constante l’humilité, ces possibilités sont prouvées, non seulement par les désertions, mais aussi par les trahisons à la cause.
Parfois, tout en reconnaissant la nécessité de punir l’individu qui a déserté pour maintenir la cohésion et la discipline du groupe, il admet certaines raisons expliquant la désertion. L’une d’elles, la plus importante peut-être, d’après nous, est l’ambiguïté de l’être du déserteur.
Du point de vue que nous défendons, un passage du récit de Che Guevara est impressionnant : c’est celui où il évoque sa présence non seulement comme guérillero, mais aussi comme médecin, dans une communauté paysanne de la Sierra Maestra. « C’est au contact de ces gens que nous avons commencé à prendre conscience de la nécessité d’un changement radical dans la vie du peuple. L’idée d’une réforme agraire prenait corps dans notre esprit, et la communion avec le peuple cessa d’être une théorie pour devenir une partie intégrante de notre être. La guérilla et la paysannerie ne devenaient plus qu’une, sans que nul ne puisse dire exactement quand cette fusion s’était produite, ni à quel moment nous étions devenus intimement convaincus que nous faisions partie de la masse paysanne. Je sais seulement, en ce qui me concerne, que ces consultations dans la Sierra ont transformé ce désir spontané, quasiment lyrique, en une force d’une valeur définie et plus sereine.
Celles et ceux qui ont souffert et peuplé loyalement la Sierra Maestra n’ont jamais soupçonné (conclut-il avec humilité) « qu’[ils] avaient participé à ce point à forger notre idéologie révolutionnaire3 ».
Observons comment Che Guevara insiste sur la communion avec le peuple comme moment décisif ayant transformé ce qui était un « désir spontané, quasiment lyrique, en une force d’une valeur définie et plus sereine ». Et il explique qu’à partir de cette communion, les paysans, même s’ils ne l’ont pas perçu, sont devenus celles et ceux qui « ont forgé » leur « idéologie révolutionnaire ».
C’est là, dans son dialogue avec les masses paysannes, que sa praxis révolutionnaire a pris une direction définitive. Mais ce que Che Guevara n’a pas exprimé, peut-être par humilité, c’est que ce sont exactement cette humilité et sa capacité d’aimer qui ont rendu possible sa « communion » avec le peuple. Et cette communion, sans nul doute dialogique, est devenue co-opération.
Voyons comment un leader comme Che Guevara, qui n’a pas monté la Sierra avec Fidel Castro et ses camarades à la façon d’un jeune frustré en quête d’aventures, reconnaît que sa « communion avec le peuple cessa d’être une théorie pour devenir une partie intégrante de [son] être. »
Jusque dans sa façon unique de narrer les moments de son expérience et de celle de ses camarades, de parler de ses rencontres avec le « peuple pauvre et loyal », dans un langage parfois presque évangélique, cet homme exceptionnel révélait une profonde aptitude à aimer et à communiquer. C’est ce qui rend la force de son témoignage aussi ardente que celle d’un autre être plein d’amour, « le prêtre guérillero » Camilo Torres4.
Sans cette communion, qui engendre une véritable co-opération, le peuple aurait simplement été l’objet de l’action révolutionnaire des femmes et des hommes de la Sierra.
Et dans ce cas, l’adhésion que le Che évoque également n’aurait pu avoir lieu. Au maximum, il y aurait eu « adhérence », et avec l’adhérence on ne fait pas la révolution, on domine.
C’est pourquoi la théorie de l’action dialogique exige que l’action révolutionnaire, peu importe son stade, soit toujours en communion avec les masses populaires, car elle ne peut s’en passer.
La communion entraîne la co-opération, qui conduit les leaders et les masses à cette fusion évoquée par le grand leader disparu. Une fusion qui n’existe que si l’action révolutionnaire est réellement humaine5, donc sympathique, aimante, communicante, humble, afin d’être libératrice.
La révolution est biophile, créatrice de vie, même si elle est obligée, pour la créer, d’interrompre des vies qui vont à l’encontre de la vie.
Il n’y a pas de vie sans mort, comme il n’y a pas de mort sans vie, mais il y a aussi une « mort en vie ». Et la « mort en vie » est exactement la vie que l’on empêche de vivre.
Il n’est même pas nécessaire d’utiliser des données statistiques pour montrer combien, au Brésil et en Amérique latine en général, il y a de « morts en vie », «d’ombres» de personnes, d’hommes, de femmes et d’enfants, acculés au désespoir et soumis6 à une permanente « guerre invisible » où le peu de vie qu’il leur reste est dévoré par la tuberculose, la bilharziose, la diarrhée infantile, par mille maladies de la misère, que les oppresseurs qualifient pour beaucoup de « maladies tropicales » […]
Face à de telles situations, comme le dit le père Chenu, « beaucoup, autant chez les prêtres conciliaires que chez les laïcs informés, redoutent que, dans la considération des besoins et des misères du monde, nous nous limitions à une abjuration émouvante pour pallier la misère et l’injustice dans ses manifestations et ses symptômes, sans aller jusqu’à analyser ces causes ni à dénoncer le régime qui sécrète cette injustice et engendre cette misère7 ».
Ce que propose la théorie de l’action dialogique est justement de dénoncer le « régime qui sécrète cette injustice et engendre cette misère » avec ses victimes, afin de chercher la libération des êtres humains en co-opération avec elles.
[…]
Organisation
Alors que dans la théorie de l’action anti-dialogique, la manipulation, au service de la conquête, est indispensable à l’acte dominateur, c’est son exact contraire que l’on retrouve dans la théorie dialogique de l’action : l’organisation des masses populaires.
L’organisation n’est pas seulement directement liée à leur unité, elle en est aussi un prolongement naturel. Ainsi, en cherchant à obtenir l’unité des masses populaires, les leaders cherchent aussi à les organiser, ce qui implique de leur montrer que l’effort de libération est une tâche commune.Ce témoignage constant, humble et courageux de l’exercice d’une tâche commune – celle de la libération des êtres humains – évite le risque des dirigismes anti-dialogiques.
Ce qui peut varier, en fonction des conditions historiques d’une société donnée, est la manière de témoigner. Mais le témoignage en soi est un composant de l’action révolutionnaire.
C’est pourquoi s’impose, pour déterminer son contenu et sa forme, une connaissance de plus en plus critique du moment historique où se produit l’action, de la vision du monde que les masses populaires ont ou commencent à avoir, et de la perception claire de la contradiction principale que vit la société.
Ces dimensions du témoignage étant historiques, le sujet dialogique, qui est dialectique, ne peut les importer simplement d’autres contextes sans analyser le sien au préalable. Dans le cas contraire, il rendrait le relatif absolu et, en le mythifiant, il ne pourrait se soustraire à l’aliénation.
Le témoignage, dans la théorie dialogique de l’action, est l’une des connotations essentielles du caractère culturel et pédagogique de la révolution.
Parmi les composantes du témoignage, qui ne varient pas historiquement, se trouvent d’abord la cohérence entre la parole et l’acte de la personne qui témoigne, ensuite son audace, qui l’amène à affronter l’existence comme un risque permanent, enfin la radicalisation, et jamais le sectarisme, dans le choix qui la conduit, ainsi que celles et ceux à qui elle donne ce témoignage, de plus en plus vers l’action. Mais aussi le courage d’aimer, qui ne signifie clairement pas s’habituer au monde injuste, mais le transformer pour une libération croissante des êtres humains. La foi envers les masses populaires, puisque c’est à elles que s’adresse le témoignage – même si celui-ci, au sein de la totalité où elles se trouvent, en relation dialectique avec les élites dominatrices, affecte aussi ces élites, qui lui répondent dans le cadre normal de leur seuil de tolérance.
Tout témoignage authentique, donc critique, suppose l’audace de prendre des risques, notamment celui de ne pas toujours obtenir immédiatement l’adhésion espérée des masses populaires.
Il est en effet possible qu’un témoignage qui, à un moment donné et dans certaines conditions, n’a pas porté ses fruits le fasse le lendemain. De fait, dans la mesure où le témoignage n’est pas un geste en l’air, mais une action, une confrontation avec le monde et les êtres humains, il n’est pas statique, mais dynamique, il fait partie de tout le contexte social dans lequel il se tient. Et peu à peu il ne s’arrête plus8.
Alors que dans l’action anti-dialogique la manipulation, en « anesthésiant » les masses populaires, favorise leur domination, dans l’action dialogique elle cède sa place à la véritable organisation. Dans la première, la manipulation est au service de la conquête. Dans la seconde, le témoignage, audacieux et aimant, est au service de l’organisation, qui n’est pas seulement liée à l’union des masses populaires, mais en est aussi un prolongement.
[…]
Synthèse culturelle
Tout au long de ce chapitre nous avons affirmé, de façon implicite ou explicite, que toute action culturelle est toujours une forme systématisée et délibérée de l’action qui s’exerce sur la structure sociale, soit dans le sens de la garder en l’état, ou plus ou moins telle quelle, soit dans le but de la transformer.
Ainsi, en tant que forme d’action délibérée et systématique, toute action culturelle a sa théorie qui, en déterminant ses objectifs, délimite ses méthodes.
L’action culturelle est soit au service de la domination – dont les agents peuvent être conscients ou non –, soit au service de la libération des êtres humains.
Dans les deux cas, dialectiquement opposés, elle opère dans et sur la structure sociale, qui se constitue dans la relation dialectique permanence/changement.
C’est ce qui explique que la structure sociale, pour être, doit devenir ou, en d’autres termes : être en devenir permet à la structure sociale de durer, dans l’acception bergsonienne du terme9.
L’action culturelle dialogique, dont nous finalisons ici l’analyse des caractéristiques, doit viser non pas la disparition de cette relation dialectique (ce qui serait impossible, car une telle disparition provoquerait la désintégration de la structure sociale elle-même et, par conséquent, celle des êtres humains), mais le dépassement des contradictions, qui aboutit à la libération des femmes et des hommes.
Dans un autre sens, l’objectif de l’action culturelle anti-dialogique est de mythifier ces contradictions pour éviter ou entraver, autant que faire se peut, la transformation radicale de la réalité.
En somme, l’intention que l’action anti-dialogique porte en elle, de façon explicite ou implicite, est de faire perdurer, dans la « structure » sociale, les situations qui favorisent ses agents.
Si bien que ceux-ci, refusant toujours la transformation de la structure, n’acceptent que les réformes n’affectant pas leur pouvoir de décision, dans lequel ils puisent la force de prescrire leurs objectifs aux masses dominées.
C’est la raison pour laquelle ce type d’action implique la conquête des masses populaires, leur division, leur manipulation et l’invasion culturelle. Et c’est aussi pour cela qu’elle est toujours, dans son ensemble, une action imposée, incapable de dépasser ce caractère qui lui est fondamental.
Au contraire, ce qui caractérise essentiellement l’action culturelle dialogique, dans son ensemble aussi, est le dépassement de tout aspect imposé.
L’objectif dominateur de l’action culturelle anti-dialogique l’empêche de dépasser son caractère impératif, alors que l’objectif libérateur de l’action culturelle dialogique lui permet de dépasser cet aspect.
Dans l’invasion culturelle, les acteur·rices puisent forcément dans leur cadre idéologique et de valeurs le contenu thématique pour leur action, partant ainsi de leur monde pour pénétrer dans celui des êtres envahis. À l’inverse, dans la synthèse culturelle, les acteur·rices, dès lors qu’iels atteignent le monde populaire, ne l’abordent pas comme des envahisseurs, car bien qu’iels arrivent d’un « autre monde », iels viennent pour le connaître avec le peuple et non pour lui « enseigner », transmettre ou remettre quoi que ce soit.
Dans l’invasion culturelle, les acteur·rices – qui n’ont même pas besoin d’aller personnellement vers le monde envahi, car leur action s’exerce de plus en plus par le biais d’instruments technologiques – sont toujours des acteur·rices qui se superposent, par leur démarche, aux spectateurs, leurs objets. Dans la synthèse culturelle au contraire, les acteur·rices s’intègrent aux femmes et aux hommes du peuple, eux aussi acteurs de l’action qu’ils exercent ensemble sur le monde.
Dans l’invasion culturelle, les spectateurs et la réalité, qui doit être maintenue en l’état, sont l’objet de l’action des acteurs. Dans la synthèse culturelle, où il n’y a pas de spectateurs, la réalité à transformer pour la libération des êtres humains est l’objet de l’action des acteurs.
Tout cela implique que la synthèse culturelle est le type d’action qui permettra de constituer, culturellement, un front contre la force de la culture qui œuvre au maintien des structures où elle se forme.
Ce mode d’action culturelle, en tant qu’action historique, se présente donc comme un instrument de dépassement de la culture aliénée et aliénante.
C’est en ce sens que toute révolution, si elle est authentique, doit aussi être une révolution culturelle.
La recherche des thèmes générateurs ou de la thématique significative du peuple, ayant pour objectif principal de saisir ses thèmes essentiels, dont la connaissance est indispensable pour élaborer avec lui les contenus des programmes de toute action, s’instaure comme point de départ du processus de l’action de synthèse culturelle.
Ainsi est-il impossible de séparer les deux phases de ce processus : la recherche thématique et l’action comme synthèse culturelle.
Cette dichotomie impliquerait que le peuple serait d’abord étudié, analysé, examiné, comme objet passif des chercheuses et des chercheurs – ce qui est le propre de l’action anti-dialogique.
Cette séparation naïve signifierait que l’action, comme synthèse, partirait de l’action comme invasion. C’est précisément parce que cette division ne peut avoir lieu dans la théorie dialogique que la recherche thématique a pour sujets du processus non seulement les chercheurs et chercheuses professionnelles, mais aussi les femmes et les hommes du peuple, dont on cherche l’univers thématique.Dans cette première phase de l’action de synthèse culturelle qu’est la recherche, un climat de créativité commence à s’installer, qui ne s’arrêtera plus et qui aura tendance à se développer dans les étapes suivantes.
Or ce climat est inexistant dans l’invasion culturelle qui, par sa nature aliénante, anesthésie l’esprit créateur des êtres envahis et leur ôte tout espoir, tant qu’ils ne luttent pas contre elle, pour ne leur laisser que la crainte de prendre le risque de s’aventurer – risque sans lequel il n’y a pas de créativité authentique.
C’est en cela qu’ils dépassent difficilement, quel que soit leur niveau, les modèles que leur prescrivent les envahisseurs.
Mais dans la synthèse culturelle, il n’y a pas d’envahisseurs ni de modèles imposés, aussi les acteurs s’insèrent-ils peu à peu en tant que sujets dans le processus historique, en prenant la réalité pour objet de leur analyse critique, jamais séparée de l’action.
Au lieu de schémas prescrits, les leaders et le peuple créent ensemble les grandes lignes de leur action. Les uns et les autres, via cette synthèse, renaissent en quelque sorte dans une nouvelle action et un nouveau savoir, qui ne sont pas seulement ceux des leaders, mais ceux des leaders et du peuple. Ce savoir est la connaissance de la culture aliénée qui, en impliquant l’action transformatrice, donnera lieu à la culture qui se désaliène.
Le savoir le plus sûr des leaders renaît dans la connaissance empirique du peuple, tandis que cette connaissance acquiert plus de sens dans ce savoir.
Ainsi, c’est dans la synthèse culturelle – et seulement dans celle-ci – que se résout la contradiction entre la vision du monde des leaders et celle du peuple, par un enrichissement commun.
La synthèse culturelle ne nie pas les différences entre chaque vision, au contraire, elle les prend pour fondations. Elle rejette l’invasion de l’une par l’autre. Elle affirme la contribution indiscutable que l’une apporte à l’autre.
C’est pourquoi les leaders révolutionnaires ne peuvent se constituer en dehors du peuple, délibérément : cela les conduirait à une inévitable invasion culturelle.
Ainsi, même s’ils apparaissent en contradiction avec le peuple, à cause de certaines conditions historiques, et selon l’hypothèse envisagée plus haut, leur rôle est de résoudre cette contradiction accidentelle. Et ils ne pourront jamais le faire par le biais de « l’invasion », ce qui augmenterait la contradiction. Il n’y a d’autre voie que la synthèse culturelle.
Les leaders commettent nombre d’erreurs et de fautes quand ils ne tiennent pas compte de cette chose si réelle qui est la vision du monde qu’a ou que développe le peuple. Une vision du monde où l’on retrouve pêle-mêle, explicites et implicites, ses aspirations, ses doutes, ses espoirs, sa façon d’envisager les leaders, sa perception de lui-même et de l’oppresseur, ses croyances religieuses, presque toujours syncrétiques, son fatalisme, sa réaction de rébellion. Et tous ces éléments, nous le répétons, ne peuvent être envisagés séparément, parce qu’ils forment, dans leurs interactions, un tout.
La connaissance de ce tout n’a d’autre intérêt, pour l’oppresseur, que de l’aider à mener son action d’invasion, pour dominer ou maintenir la domination, alors qu’elle est indispensable aux leaders révolutionnaires pour réaliser leur action de synthèse culturelle.
Celle-ci, dans la théorie dialogique de l’action – et c’est en cela même qu’elle est synthèse –, n’implique pas que les objectifs de l’action révolutionnaire doivent se cantonner aux aspirations émanant de la vision du monde du peuple.
Si tel était le cas, au nom du respect de la vision populaire du monde, respect qui doit vraiment exister, les leaders révolutionnaires finiraient par être passifs face à cette vision.
Il ne faut accepter ni l’invasion des leaders dans la vision populaire du monde ni l’adaptation des leaders aux aspirations, bien souvent naïves, du peuple.
Soyons plus précis. D’après nous, si à un moment historique donné, l’aspiration essentielle du peuple ne dépasse pas la revendication salariale, les leaders peuvent commettre deux erreurs : restreindre leur action à la stimulation excessive de cette revendication, ou se superposer à cette aspiration, en proposant quelque chose qui va au-delà. Quelque chose qui n’est pas encore pour le peuple un élément « distinct en soi ».
Dans le premier cas, les leaders révolutionnaires tomberaient dans l’adaptation ou la subordination à l’aspiration populaire. Dans le second, ils pratiqueraient l’invasion culturelle, au mépris de l’aspiration du peuple.
La solution se trouve dans la synthèse. D’une part, s’incorporer au peuple dans son aspiration revendicative. De l’autre, problématiser la signification de cette même revendication.
Ce faisant, le peuple interrogera sa situation historique réelle, concrète, dont l’une des dimensions, au sein de sa totalité, est la revendication salariale.
Il sera alors évident que la revendication salariale, toute seule, n’incarne pas la solution définitive. Que celle-ci se trouve dans le fait que «si les travailleurs ne parviennent pas, d’une certaine manière, à être propriétaires de leur travail, toutes les réformes structurelles seront inefficaces », pour reprendre les mots de Monseigneur Franić dans le document, déjà cité, émanant des évêques du Tiers Monde.
Ce qui est donc fondamental, comme insiste l’évêque, est qu’ils parviennent à « être propriétaires et non vendeurs de leur travail », parce que « tout achat ou vente du travail est une sorte d’esclavage ».
Avoir la conscience critique qu’il est nécessaire d’être propriétaire de son travail et que « celui-ci constitue une partie de l’être humain » et que l’« être humain ne peut être vendu ni se vendre », c’est faire un pas en avant, au-delà des solutions palliatives et trompeuses. C’est s’inscrire dans une action de véritable transformation de la réalité pour, en l’humanisant, rendre leur humanité aux êtres humains.
Finalement, l’invasion culturelle, dans la théorie anti-dialogique de l’action, est au service de la manipulation, qui sert à son tour la conquête, qui sert quant à elle la domination, alors que la synthèse est au service de l’organisation, qui sert la libération.
Tout notre effort dans cet essai a été de dresser ce constat évident : tout comme l’oppresseur, pour opprimer, a besoin d’une théorie de l’action oppressive, les opprimé·es, pour se libérer, ont aussi besoin d’une théorie de leur action.
L’oppresseur, forcément, élabore une théorie de son action sans le peuple, puisqu’il va à son encontre.
Le peuple, à son tour, tant qu’il est écrasé et opprimé, qu’il introjecte l’oppresseur, ne peut, tout seul, constituer la théorie de son action libératrice. C’est seulement dans sa rencontre avec les leaders révolutionnaires, dans leur communion, dans leur praxis commune, que cette théorie se fait et se refait.
La réflexion sur la question de la pédagogie des opprimé·es, que nous avons tenté de mener dans des termes approximatifs et simplement introductifs, nous a conduits à l’analyse, tout aussi approximative et introductive, de la théorie de l’action anti-dialogique, au service de l’oppression, et de la théorie dialogique de l’action, au service de la libération.
Nous serions donc heureux si, venant des potentiels lecteurs et lectrices de cet essai, surgissaient des critiques à même de rectifier des erreurs et confusions, d’approfondir certaines affirmations et de remarquer ce que nous n’avons pas vu.
Certaines de ces critiques chercheront peut-être à nous retirer le droit de parler du sujet traité dans ce chapitre, sur lequel nous n’avons pas d’expérience de participation. Il nous semble, toutefois, que notre manque d’expérience dans le champ révolutionnaire ne nous ôte en rien la possibilité de réfléchir à ce thème.
De fait, dans l’expérience relative que nous avons eue avec les masses populaires en tant qu’éducateurs et éducatrices recourant à une éducation dialogique et problématisatrice, nous avons accumulé un matériel relativement riche, suffisamment pour nous mettre au défi de prendre le risque des affirmations que nous avons émises.
Si rien ne venait à rester de ces pages, nous espérons au moins que quelque chose subsistera : notre confiance envers le peuple. Notre foi envers les êtres humains et en la création d’un monde où il serait moins difficile d’aimer.
Martin Buber, Je et tu, trad. Geneviève Bianquis, Paris, Aubier, [1938] 2012.↩︎
Ernesto Guevara, Souvenirs…, op. cit., p.172.↩︎
Ibid., p.95 (l’italique nous est propre).↩︎
C. Torres Restrepo (1929-1966) était un prêtre catholique colombien et un précurseur de la théologie de la libération. Cofondateur de la première faculté de sociologie d’Amérique latine (1960), Torres tentait d’unir pensée marxiste et foi chrétienne dans un projet commun. Ayant rejoint la guérilla de l’Armée de libération nationale (ELN) comme simple combattant, il meurt lors de son premier combat. Figure incontournable de la culture populaire en Colombie et en Amérique latine. [nde]↩︎
Sur la défense de l’homme face à « sa mort », « après la mort de Dieu », lire Mikel Dufrenne, Pour L’homme, Paris, Seuil, 1968.↩︎
« La plupart d’entre eux, dit Gerassi, en parlant des paysans, se vendent ou vendent des membres de leur famille pour travailler comme esclaves, afin d’échapper à la mort. Un journal de Belo Horizonte a découvert pas moins de 50 000 victimes (vendues à 1500 cruzeiros), et pour le prouver le reporter a acheté un homme à sa femme pour 30 dollars. “J’ai vu beaucoup de gens mourir de faim, explique l’esclave, donc ça ne me dérange pas d’être vendu.” Quand un trafiquant d’êtres humains a été arrêté à São Paulo, en 1959, il a reconnu avoir des contacts avec des fazendeiros [grands propriétaires terriens] de São Paulo, des propriétaires de plantations de café et d’entreprises du bâtiment, intéressés par sa marchandise – excepté, toutefois, les adolescentes, qui étaient vendues à des bordels. ». John Gerassi, A invasão da América Latina, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1965, p. 120 ou The Great Fear, the Reconquest of Latin America by Latin Americans, New York, Macmillan C° et Londres, Collier-Macmillan, 1963.↩︎
Marie-Dominique Chenu, o.p., Témoignage chrétien, avril 1964 in André Maine, Cristianos y marxistas después del concilio, Buenos Aires, Editorial Arandu, 1965, p. 167. [Notre traduction]↩︎
En tant que processus, le véritable témoignage qui n’a pas fructifié ne rencontre pas, à ce moment négatif, un échec absolu. On connaît des cas de leaders révolutionnaires dont le témoignage n’est pas mort avec leur mort, due à la répression des oppresseurs.↩︎
En réalité, ce qui fait qu’une structure est sociale et, donc, historico-culturelle n’est pas la permanence ni le changement, pris dans l’absolu, mais la relation dialectique entre eux. En dernière analyse, ce qui demeure dans la structure sociale n’est ni la permanence ni le changement, mais la durée de la relation dialectique permanence/changement.↩︎