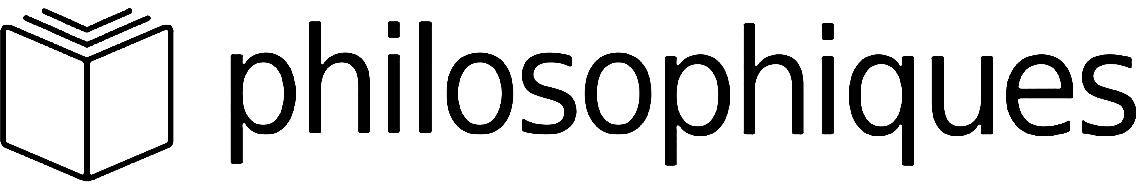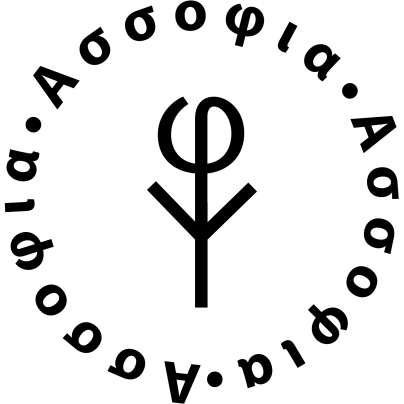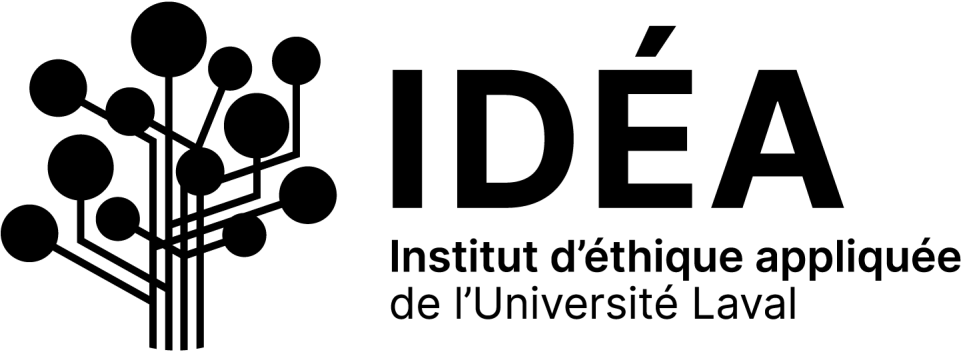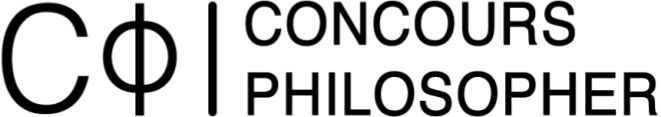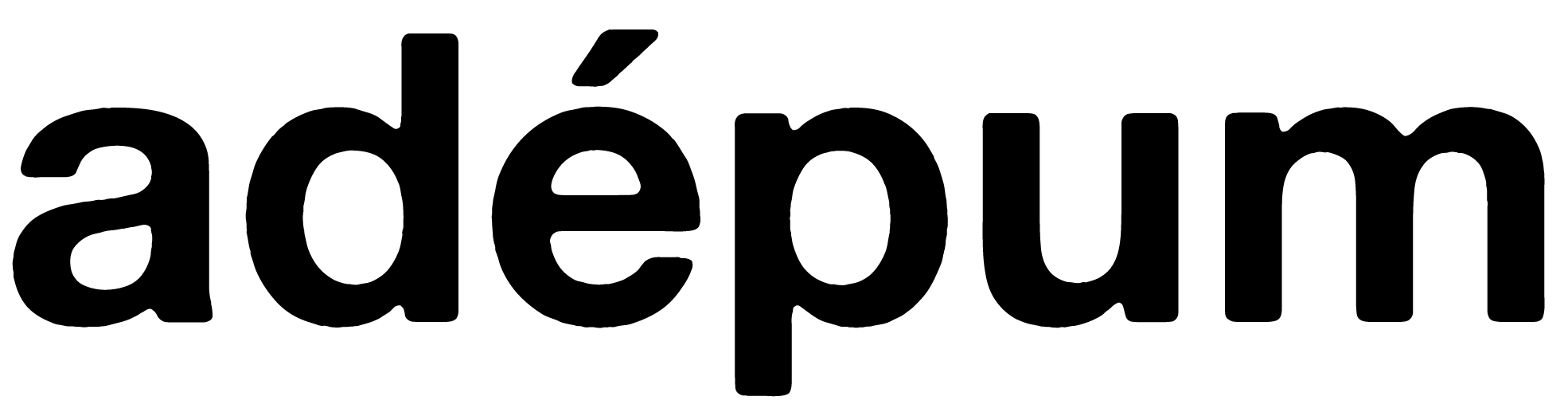No. 03 — Philosophie et environnement
Pluraliser la durabilité
Christian Djoko Kamgain, Université LavalDate de publication: 2025-07-01
Résumé
Cet article interroge les fondements ontologiques de la crise écologique contemporaine et critique l'imposition d'un modèle hégémonique de durabilité issu du dualisme occidental. Ce dernier, en dissociant nature et culture, a non seulement favorisé l'écocide mais a également justifié l'unimondisme -- un universalisme épistémologique qui efface les savoirs et pratiques non occidentaux sous prétexte de rationalité objective. Ce processus perpétue une domination coloniale dans les politiques environnementales globales, réduisant la diversité des écologies locales à une norme unique. Face à cette impasse, nous plaidons pour une pluralisation de la durabilité, c'est-à-dire une reconnaissance active des multiples régimes ontologiques et éco-éthiques du monde. Cette approche, en valorisant les savoirs situés et les cosmologies alternatives, ouvre la voie à une préservation du vivant qui ne soit ni standardisée ni imposée, mais ancrée dans la diversité des manières d'habiter le monde de la vie.
Mots-clés: érudite, dualisme, naturalisme, écocide, unimondisme, pluralisme, durabilité
Télécharger en PDF
Introduction
La crise écologique contemporaine ne saurait être réduite à un simple enjeu économique, politique ou technologique : elle est d’abord une crise de la pensée. Au cœur de cette crise se trouve un dualisme ontologique propre à la modernité occidentale, qui a institué une séparation radicale entre l’humain et la nature. Cette fracture conceptuelle, loin d’être neutre, a façonné les rapports au vivant en les subordonnant aux logiques d’objectivation et d’exploitation, conduisant ainsi à l’écocide global que nous connaissons aujourd’hui.
Ce dualisme ne s’est pas seulement déployé comme une structure intellectuelle cantonnée à l’intérieur de l’Occident. Porté par l’unimondisme occidental - ce processus par lequel une épistémologie située s’est érigée en étalon universel du vrai et du juste - il s’est diffusé à l’échelle mondiale. Ce régime de pensée a non seulement invisibilisé la pluralité des régimes ontologiques existants, mais il a également infusé les politiques mondiales de conservation de la nature, souvent sous une forme néocoloniale qui cannibalise ou marginalise les savoirs et pratiques écologiques non occidentaux.
Face à cette dynamique qui aggrave la crise plus qu’elle n’en conjure les effets, il devient impératif de pluraliser la durabilité. Or, pluraliser la durabilité implique d’abord et avant tout de sortir de l’unimondisme occidental. Cette sortie ne consiste pas à rejeter un modèle dominant, mais à ouvrir un espace où coexistent et dialoguent des ontologies écologiques diverses. La durabilité ne peut être un concept figé et homogène : elle doit être pensée à partir de multiples ancrages culturels et ontologiques. C’est dans cette perspective que nous aborderons successivement (I) le dualisme ontologique et (II) l’unimondisme occidental et ses effets, avant d’explorer (III) la voie d’une durabilité véritablement plurielle.
I. Le dualisme occidental en procès
La conception historiquement dominante de la nature en Occident, comme l’a montré Hans Jonas (2001, 25‑73), repose sur un dualisme ontologique qui institue une séparation entre les humains et les non-humains, entre la nature et la culture. Mais cette séparation suppose d’abord que la nature ait été pensée comme une réalité autonome, objectivable et extérieure à l’humain. Cette extériorité rend possible la prise de conscience d’un rapport prédateur entre l’homme et la nature, puis la formulation d’un impératif de protection, conditionné par la reconnaissance des menaces pesant sur elle. Or, ce même dualisme, en légitimant l’idée d’un humain « maître et possesseur » du monde, ne cesse paradoxalement de creuser la séparation qu’il prétend dépasser. Il impose ainsi une question fondatrice : « Où s’arrête la nature ? » - question à laquelle Alfred Whitehead (1955, 20) répond en soulignant que, dans la pensée occidentale, « les bords de la nature sont toujours en lambeaux ».
Ce schéma dualiste se heurte à l’expérience ontologique d’autres civilisations, notamment celles du Sud global, où la notion de nature, en tant que domaine distinct de l’humain, est souvent dépourvue de pertinence. Le chaman brésilien Yanomami illustre bien cette divergence lorsqu’il déclare : « Ce que vous nommez “ environnement ”, c’est ce qui reste de ce que vous avez détruit » (cité par Descola 1999, 37). De même, pour un pygmée Baka du Bassin du Congo, dont la cosmologie repose sur un enchevêtrement relationnel entre tous les vivants, l’idée de protéger la nature au sens occidental apparaît peu intelligible. Chez le peuple Bamiléké du Cameroun, la culture ne sépare pas l’humain du reste du vivant. Le lien inextricable entre les êtres – humains, plantes, animaux – n’y constitue pas un scandale logique, mais l’évidence d’un monde de la vie où nature et culture s’entrelacent dans un continuum. Le milieu de vie y est à la fois biologique, symbolique, spirituel et mémoriel, tissé d’interdépendances qui défient la pensée dualiste occidentale.
Ces conceptions, étudiées notamment par Philippe Descola (2005, 220‑353), révèlent que le naturalisme occidental, qui tend à voir dans la culture une manière de s’extraire de la nature pour mieux la maîtriser, n’est ni universel ni nécessaire. Dans de nombreuses communautés autochtones d’Afrique, d’Amérique latine ou d’Australie, la différence entre humains et non-humains est une question de degré et non d’essence. Là où l’Occident impose une rupture radicale, ces sociétés maintiennent une continuité du vivant qui rend caduque l’opposition nature/culture.
Ainsi, bien que portés par une volonté sincère de soustraire la nature à l’emprise de l’arraisonnement capitaliste (au sens heideggérien) 1, de nombreux courants de pensée et mouvements écologistes influents ont, depuis longtemps, promu l’idée de la « protection de la nature ». Pourtant, cette approche, loin d’être neutre, repose sur un malentendu ontologique fondamental. Ce n’est pas tant la nature en elle-même qui est protégée que l’idée spécifiquement occidentale que l’on s’en fait. En adoptant et promouvant des normes environnementales forgées dans le cadre conceptuel de la modernité occidentale, ces mouvements ont paradoxalement contribué à renforcer l’opposition entre l’humain et la nature, une dichotomie qui leur est propre. Or, comme nous le verrons dans les sections suivantes, cette manière d’appréhender le monde n’a rien d’universel : entre l’Occident et d’autres horizons civilisationnels, les paradigmes diffèrent profondément, orientant de manière significative la façon dont les peuples conçoivent et pratiquent la préservation du monde de la vie. Autrement dit, dans les sociétés non occidentales, où les rapports au vivant ne sont pas structurés par le dualisme ontologique, les modalités de gestion et de préservation du monde de la vie obéissent à des logiques différentes. L’idée de sanctuariser la nature en excluant l’humain, loin d’être une évidence universelle, peut y apparaître comme le prolongement d’une vision exotisante et colonialiste. À l’image du « mythe de la forêt perdue » (Blanc 2020, 157), cette approche tend à occulter les écologies locales et les interactions diversement médiées entre les sociétés humaines et leur milieu.
Au fond, cette conception de la nature s’est imposée dans le sillage de l’unimondisme qui caractérise la civilisation occidentale depuis au moins 1492, date qui marque, selon le philosophe argentin Enrique Dussel (Dussel 1992), l’occultation de l’autre. Loin d’une simple projection culturelle, il s’agit de la colonialité du pouvoir (Mignolo 2001) qui a façonné la manière dont le monde se pense et se structure autour d’un paradigme unique, reléguant d’autres modes d’être et de savoir au rang d’altérités subalternes.
S’affranchir de cette logique asymétrique et coloniale n’est pas un luxe intellectuel, mais une nécessité impérative si l’on veut véritablement œuvrer à la préservation durable du monde de la vie.
II. Sortir de l’unimondisme occidental
L’unimondisme est le processus épistémologique d’effacement double : d’une part, il occulte l’Occident en tant que point de vue situé ; d’autre part, il gomme l’Autre en tant qu’Autre. Au moins depuis 1492, ce mécanisme permet à l’Occident de s’ériger en mesure universelle de toute culture, histoire ou civilisation. C’est le point de vue qui, en se hissant ingénument au sommet d’une hiérarchie qu’il a préalablement établie, se présente comme le « point hors-sol de l’astronaute » (Ferdinand 2019, 140) ou le point zéro, c’est-à-dire le « point de vue qui cache le point de vue particulier comme s’il se situait dans un au-delà de tout point de vue, un point de vue qui se présente comme n’ayant aucun point de vue » (Grosfoguel 2006, 53). Autrement dit, détaché de l’expérience singulière qui l’a vu naître, l’unimondisme occidental érige son ontologie en référent absolu, l’imposant comme seule grille d’intelligibilité du réel, et, ce faisant, cannibalise les autres visions du monde.
Dans cette logique, l’Occident adresse aux autres régions du monde une injonction paternaliste, que l’on pourrait, de manière certes schématique, résumer ainsi : « Vous n’avez ni la maturité ni les outils conceptuels pour résoudre la crise écologique que nous avons créée ; nous allons vous montrer la voie ». Cette attitude repose sur un biais fondamental : celui de ne pas reconnaître la pluralité des ontologies et des modes d’habiter le monde. Malcom Ferdinand (Ferdinand 2019, 56) parlerait à cet égard d’un « habiter colonial ». Cet habiter (du modèle occidental) est un habiter-sans-l’autre, précisément parce que cet autre a été effacé à travers un processus de hiérarchisation, de réduction au silence et d’invisibilisation des écologies, des régimes ontologiques et des façons d’habiter le monde.
Ce modèle s’impose par le biais des organisations non gouvernementales (ONG), des médias, des institutions de recherche et des grandes entreprises « écoresponsables », qui dictent les conditions d’une durabilité conforme aux présupposés occidentaux. Ce faisant, les peuples non occidentaux sont privés de légitimité pour penser la crise et ses solutions, tandis que leurs savoirs et pratiques écologiques sont marginalisés, cannibalisés ou réinterprétés à travers un prisme exotisant.
Catherine Larrère (2011, 69) illustre ce phénomène avec la transposition du modèle américain de wilderness à des contextes où il est inadapté : l’imposition de parcs naturels en Asie du Sud-Est, par exemple, conduit à l’expropriation des populations locales sous prétexte de conservation, alors même que ces sociétés vivent en interdépendance avec leur environnement. Il ne s’agit plus de protéger la nature, mais de la sanctuariser à l’image d’un espace récréatif conçu pour des visiteurs étrangers.
Dans une perspective critique beaucoup plus large des politiques occidentales, Arturo Escobar dresse un tableau d’une redoutable lucidité qui mérite d’être cité in extenso :
Fondée sur ce que nous avons nommé une « ontologie dualiste » (qui sépare l’humain et le non-humain, la nature et la culture, l’individu et la communauté, « nous » et « eux », l’esprit et le corps, le séculaire et le sacré, la raison et l’émotion, etc.), cette modernité s’est arrogée le droit d’être « le » monde (civilisé, libre, rationnel), au détriment des autres mondes existants ou possibles. Ce projet « unimondiste » a fait son chemin. Il arrive aujourd’hui à son paroxysme avec la globalisation néolibérale capitaliste et individualiste et la rationalité particulière qui la caractérise. Il a entrainé l’érosion de la base ontologique et territoriale de nombreux groupes sociaux, en particulier ceux qui mettent l’accent sur les conceptions non-dualistes du monde – celles qui ne sont pas fondées sur les séparations susmentionnées (Escobar 2018, 94).
Le droit international de l’environnement et les politiques onusiennes sont également imprégnés de cette matrice ontologique. Pensées au sein même du foyer civilisationnel qui a généré la crise écologique, ces normes prétendent y remédier sans interroger leurs propres présupposés. Cette situation explique la récurrence des échecs et des contradictions dans les initiatives écologiques mondiales : en érigeant la mise sous cloche de la nature en dogme, elles prolongent la logique extractiviste sous une forme inversée, en excluant les humains de leur propre milieu de vie. Cet « écologisme hors-sol » (Ferdinand 2019, 128) ignore que la relation au vivant ne peut être dissociée des contextes culturels et historiques dans lesquels elle s’inscrit.
Somme toute, loin de résoudre la crise écologique, cette approche la perpétue en réaffirmant la centralité d’un régime ontologique dualiste et hégémonique. L’enjeu, vous l’aurez compris, n’est pas seulement environnemental : il est avant tout décolonial. Le kaléidoscope des régimes ontologiques à travers le monde permet de dénier au dualisme occidental le point de vue de Sirius, tout en affirmant sans risque de se tromper que de « multiples expériences du monde peuvent cohabiter sans se contredire » (Descola 2005, 36). Outre la lutte incessante contre les inégalités sociales à l’échelle mondiale, c’est à une désoccidentalisation du regard que le monde, et plus particulièrement l’Occident dualiste, doit se soumettre, afin d’assurer de manière véritable et durable la pérennité du monde de la vie.
III. Pluraliser la durabilité
Nous avons établi dans les sections précédentes que les politiques environnementales reposent en grande partie sur une appropriation coloniale de la nature. Le dualisme et l’universel hégémonique dont s’accompagne cette appropriation constituent moins une solution qu’un obstacle à la possibilité même pour le monde de la vie d’être encore à l’avenir. Dès lors, nous avons proposé une sortie de l’unimondisme occidental fondée sur une sorte de désobéissance épistémologique, autrement dit sur un refus critique des cadres dominants du naturalisme occidental.
Une telle sortie, si nécessaire soit-elle, ne saurait cependant constituer une finalité en soi. Elle ne doit pas non plus conduire à la substitution d’un hégémonisme par un autre, fut-il alternatif. Toute entreprise de reconstruction qui prendrait appui sur une pensée unique – même sous le couvert d’une critique de l’unimondisme occidental – reconduirait en dernière instance la clôture du possible et la réduction du pensable. Loin de toute tentation d’un autre dogmatisme, la sortie de l’unimondisme ouvre plutôt sur une nécessité plus radicale encore : la pluralisation des conceptions du monde et des formes de durabilité. Pluraliser ou périr – telle pourrait être la maxime de cette nouvelle orientation.
L’enjeu de cette pluralisation est double. Il s’agit, d’une part, de reconnaître la manière dont la diversité culturelle contribue à la diversité biologique et à la richesse des sensibilités écologiques. D’autre part, il s’agit d’examiner comment les multiples façons de « mondifier » la vie (Escobar 2018, 130), c’est-à-dire d’en produire des significations et des rapports différenciés, peuvent participer à sa préservation. En rupture avec toute approche qui homogénéiserait ou standardiserait les politiques environnementales selon une matrice unique, la pluralisation consiste à créer les conditions d’une cohabitation des diverses conceptions de la durabilité en reconnaissant la pertinence des savoirs, des valeurs et des pratiques issus de différents régimes ontologiques. Loin d’imposer un cadre normatif surplombant, elle s’efforce d’aménager un espace de dialogue et une méthode de convergence entre ces diverses approches, en permettant à chaque tradition ontologique, chaque éthique environnementale (R. Larrère 2013) et chaque matrice culturelle d’exprimer son propre potentiel préservationniste. Une véritable durabilité du monde de la vie ne pourra advenir qu’en reconnaissant la multiplicité des modes d’être au monde et en permettant aux écologies locales de contribuer à la refonte des cadres de pensée et d’action.
Une précision s’impose à ce stade. Si aucune conception de la durabilité prétendant à une validité universelle et efficiente ne peut se concevoir selon un modèle uniformisant et autoritaire, il n’en découle pas pour autant que la nécessité du pluralisme implique d’adhérer à un relativisme absolu ou à une indifférenciation des cadres éthiques. Il ne s’agit ni de légitimer indistinctement toute pratique au nom de la diversité ni de s’enfermer dans des particularismes imperméables au dialogue. Autrement dit, pluraliser la durabilité ne revient pas à juxtaposer passivement des régimes ontologiques hétérogènes, mais à instaurer une dynamique active de mise en relation et de traduction réciproque des différentes manières d’habiter le monde.
Loin d’être un obstacle à la préservation du vivant, cette pluralisation constitue au contraire une condition essentielle pour penser une durabilité véritablement partagée. Elle implique la capacité de construire des passerelles entre des perspectives en apparence dissonantes, non pas en les soumettant à un cadre unique, mais en articulant leurs points de convergence autour d’un horizon de sens commun. Plus encore, elle invite à rechercher, au sein de chaque régime ontologique et de chaque tradition éthique, des équivalents fonctionnels ou des principes homéomorphes susceptibles de s’accorder avec l’impératif de préservation du monde de la vie. Ainsi, chaque peuple et chaque communauté doit pouvoir penser et formuler les conditions de la durabilité à partir de leurs référents ontologiques, ancrages territoriaux, éco-biographies et imaginaires culturels, sans pour autant exclure la possibilité d’une traduction mutuelle et d’un partage des pratiques les plus pertinentes. C’est dans cette dialectique féconde entre enracinement et ouverture, entre reconnaissance des singularités et élaboration de nouveaux espaces de cohabitation, que peut émerger une durabilité véritablement décoloniale, seule à même de répondre aux apories systémiques qui sous-tendent la crise environnementale contemporaine.
Conclusion
Loin d’être une simple question de gestion des ressources, la crise écologique contemporaine révèle une crise plus profonde : celle des cadres ontologiques qui organisent notre rapport au vivant. Le dualisme occidental, en instituant une séparation radicale entre nature et culture, a légitimé des pratiques écocidaires tout en imposant un modèle hégémonique de conservation, souvent marqué par une logique unimondiste et coloniale. Cette approche, en prétendant incarner l’universel, occulte la richesse des régimes ontologiques et des savoirs écologiques non occidentaux. La bibliothèque des valeurs et savoirs de l’humanité ne peut être réduite aux seules catégories de la modernité occidentale.
Face à cette impasse, pluraliser la durabilité apparaît comme une nécessité incontournable. Il ne s’agit pas seulement de contester l’universalisation d’un modèle unique, mais d’ouvrir un espace où coexistent et se fécondent des visions multiples du monde. Reconnaître la diversité ontologique et culturelle comme une force plutôt qu’un obstacle constitue la condition d’une véritable préservation du vivant – une préservation qui ne soit ni imposée ni homogénéisée, mais pensée à partir des multiples manières d’habiter la Terre.
Bibliographie
« L’Homme moderne considère la totalité de l’Être comme une matière première pour la production. Il soumet la totalité du monde au domaine de l’ordre de la production » (Heidegger 1950).↩︎