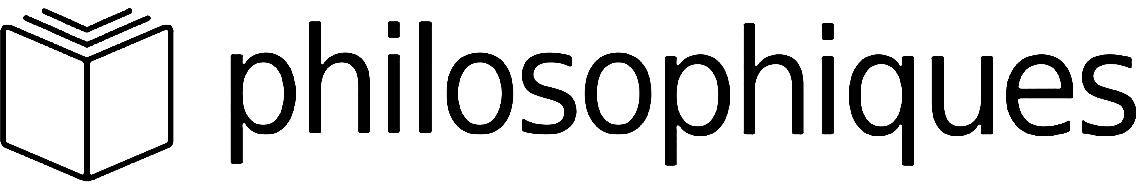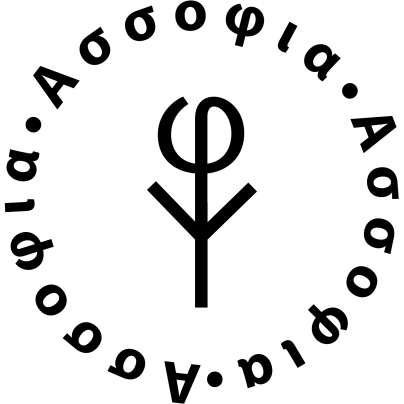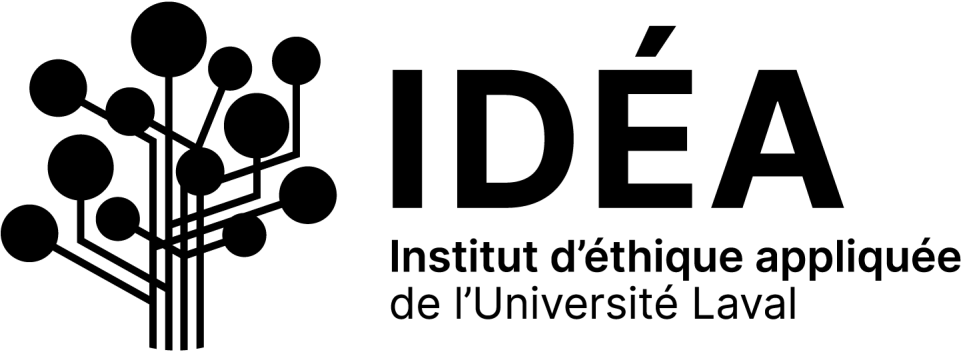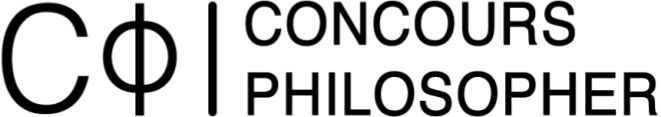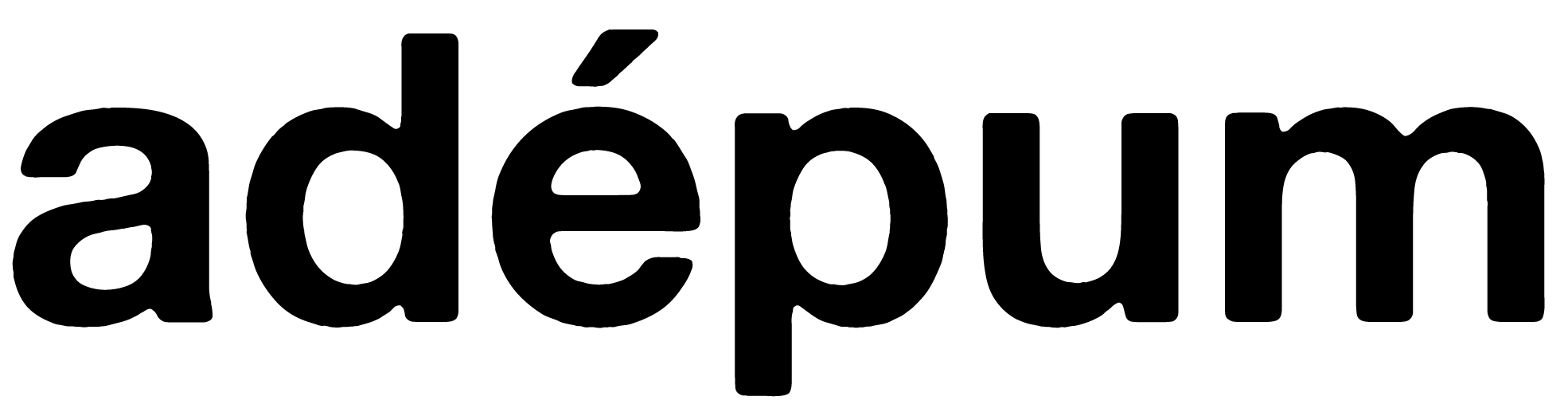Philosophie et éducation
Au Québec, l’actualité récente rend compte d’une multiplication des tensions dans le système d’éducation. Les réformes de l’éducation primaire et secondaire se multiplient au moment où les écoles font face à une pénurie de personnel enseignant. Si les conditions de travail sont souvent citées pour expliquer les problèmes de recrutement, les universités ont quand même dû revoir leur offre de formation pour permettre des passages accélérés vers la profession enseignante. On voit également une recrudescence de l’intérêt pour l’éducation à la maison. La situation en éducation supérieure est tout aussi complexe : les coupes budgétaires historiques annoncées dans le financement des cégeps et les conflits entre le gouvernement et les universités, autant sur leur formule de financement que sur les enjeux de liberté académique, ont même mené à la demande de la démission de la ministre de l’Éducation. Ces tensions et ces défis s’inscrivent dans un contexte global où les désaccords sur les mandats et les visées de l’éducation publique apparaissent de plus en plus saillants. La confiance envers les institutions s’érode : de la censure de livres et de matières à l’étude aux accusations d’endoctrinement des enfants aux coupes dans le financement du réseau de l’éducation au retrait du financement des universités de recherche, les controverses sont multiples. En même temps, les appels à l’éducation, notamment critique et scientifique, se multiplient : elle est considérée centrale à l’époque de la désinformation et de la prolifération des théories complotistes. De même, l’éducation reste un moteur social, politique et économique crucial, notamment pour l’égalité des chances, la mobilité sociale, la vie citoyenne et la formation de la main d’œuvre.
Dans ce contexte, quelle place y a-t-il pour l’école dans le monde actuel? Quel est l’avenir des systèmes d’éducation dans les régimes politiques contemporains? Comment considérer l’éducation à l’extérieur de l’école et le rôle des parents dans l’éducation des enfants? Face aux défis propres à notre époque, quelle importance revêt l’enseignement de la philosophie? En vue de quoi devrait-on enseigner? Qu’est-ce qui devrait être enseigné? Une forme de censure est-elle permissible, voire désirable? Le présent numéro souhaite approfondir la réflexion philosophique sur les enjeux en éducation. Autant les contributions au sujet de l’éducation obligatoire (préscolaire, primaire et secondaire) que l’éducation supérieure sont les bienvenues. Plusieurs perspectives peuvent être adoptées à cette fin : les suggestions qui suivent ne sont évidemment pas exhaustives.
L’histoire de la philosophie regorge de « chapitres » sur l’éducation : les philosophes ont proposé des conceptions et des finalités pour l’éducation qui ont eu de l’écho dans les façons d’envisager les processus éducatifs et vice-versa. Pensons ici au cursus adapté à la fonction politique de l’individu d’après sa nature que Platon envisage pour la constitution de la cité idéale et au rôle du précepteur face à un enfant unique et « complètement malléable » chez John Locke. Ou encore à Maria Montessori, laquelle a mis en lumière l’importance d’un environnement adapté aux enfants qui puisse répondre à leur curiosité et soutenir leur développement, qui a influencé le mouvement de l’éducation nouvelle et l’approche de l’éducation par problème défendue par John Dewey. Quels outils philosophiques sont à notre disposition pour réfléchir les défis auxquels notre société est confrontée? Quelles sont les réussites et les angles morts des philosophies de l’éducation du passé?
L’éducation peut aussi être envisagée d’après différentes approches : qu’elles soient psychologiques (Piaget, etc.), sociologiques (Durkheim, etc.), analytiques (Peters, Scheffler, etc.) ou encore critiques. Ces dernières ont été particulièrement discutées dans les dernières années : Paolo Freire invite à penser l’éducation en dehors des écoles et Ivan Illich met en lumière les limites des institutions scolaires. bell hooks propose quant à elle de revoir l’éducation offerte par nos écoles : hooks met l’accent sur l’éducation à la liberté en créant un dialogue fort et direct entre la vie et l’école. Quelles sont les contributions des différentes approches à notre réflexion sur l’éducation? Que mettent-elles en lumière du fonctionnement de nos écoles?
Parler d’éducation appelle aussi une conception par thématique ou discipline : Yuriko Saito défend l’éducation artistique par son importance dans la vie quotidienne. Christiane Gohier aborde l’éducation intellectuelle dans un prisme multiple, où le développement de la raison ne peut être envisagé séparément des dimensions symboliques et affectives du rapport au monde des individus. Nel Noddings met de l’avant une éducation au soin et aux dimensions fondamentales de la vie, comme la famille ou la parentalité, dans l’éducation formelle. Kevin McDonough réfléchit à l’éducation à la citoyenneté dans une société multiculturelle. Comment justifier l’adoption d’un cursus? Pourquoi choisit-on d’enseigner une discipline particulière plutôt qu’une autre?
Enfin, d’autres préféreront aborder l’éducation par problèmes, notamment éthiques et politiques. Des philosophes intéressés par l’éducation progressiste comme Johannes Drerup sont confrontés au problème de l’endoctrinement. Bruce Maxwell se penche d’ailleurs sur la question de la neutralité dans l’enseignement. Comment aborder la question des valeurs, notamment en vertu du désaccord raisonnable qui existe dans ce domaine, dans l’enseignement? D’autres comme Gina Schouten et Jennifer Morton se concentrent sur les inégalités et la distribution des occasions éducatives. De quelles manières doit-on organiser nos systèmes éducatifs pour répondre aux exigences de la justice? D’autres encore abordent la légitimité de l’autorité de l’État et la place de l’autorité parentale en éducation. À ce chapitre, une contribution marquante au sujet de l’éducation en démocratie est celle d’Amy Gutmann. Quelles sont les finalités de l’éducation? Qui peut en revendiquer la responsabilité?
Dans ce terreau fertile, nous encourageons toute personne intéressée par la philosophie de l’éducation et par l’éducation à la philosophie à soumettre une proposition à l’une ou l’autre des rubriques suivantes :
Érudite
Longueur des articles : 13 000 à 17 000 caractères espaces compris
Publication d’articles de vulgarisation des recherches actuelles en philosophie ayant une affinité avec la thématique du dossier. Cette section veut rendre accessible le savoir issu de la recherche en philosophie. Les articles de recherche, les commentaires critiques et les recensions de la littérature sont acceptés dans cette section à la condition que le lien avec le dossier thématique soit présent et explicite.
Argumentée
Longueur des articles : 10 000 à 12 000 caractères espaces compris
Publication de courts articles ayant pour but de défendre une prise de position philosophique en lien avec le dossier thématique. Cette section est propice au débat public sur des sujets d’actualité. Dans cet ordre d’idées, il est possible de répondre à des publications des dossiers précédents de la revue dans cette rubrique.
Créative
Longueur des articles : 1-3 pages ou 4 000 à 8 000 signes
Espace accessible et ouvert aux réflexions philosophiques de tout acabit soulevées par la thématique du dossier. Les propositions ayant une forme moins conventionnelle en philosophie sont encouragées (bande dessinée, fiction, poésie, conte, etc.).
Collégiale
Longueur des articles : 10 000 à 12 000 caractères espaces compris
Publication d’articles ayant pour but d’introduire les lecteurs à une notion ou une idée philosophique soulevée par la thématique du dossier. L’objectif de cette rubrique est de fournir aux professeur.e.s du collégial du matériel adapté à leur pratique et accessible à leurs étudiant.e.s.
Pour soumettre une proposition, veuillez consulter la section « Contribuer » de notre site web. Nous utilisons le style Chicago francisé 17e édition (format auteur-date) et nous acceptons les textes soumis en format Markdown, Word, LibreOffice, LaTeX, RTF ou TXT.
Veuillez envoyer vos textes à l’adresse : info@lampadaire.ca. Dans votre courriel de soumission, prière d’indiquer votre nom, la rubrique choisie (érudite, argumentée, créative ou collégiale), votre affiliation institutionnelle et votre programme d’étude (si applicables).
Notez que toute soumission qui ne respecte pas les lignes éditoriales de la revue (nombre de caractères, normes bibliographiques, types de fichier) sera directement renvoyée à l’auteur ou l’autrice.