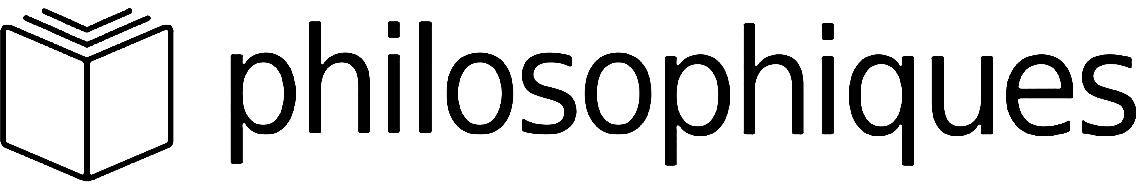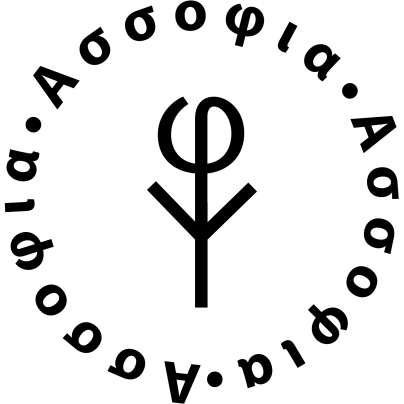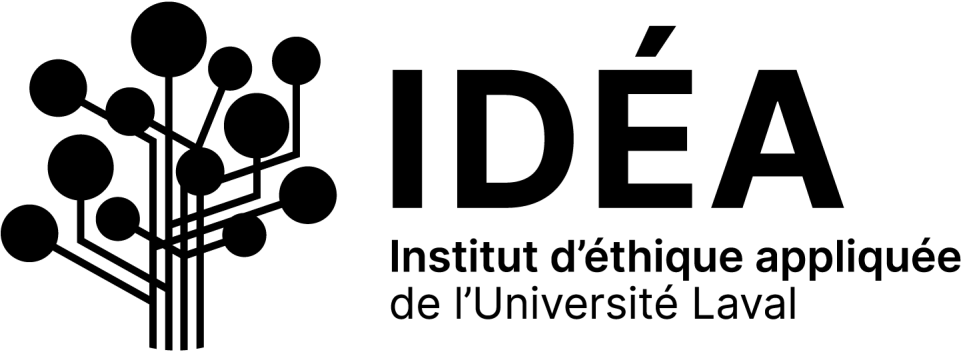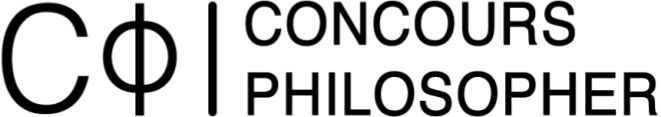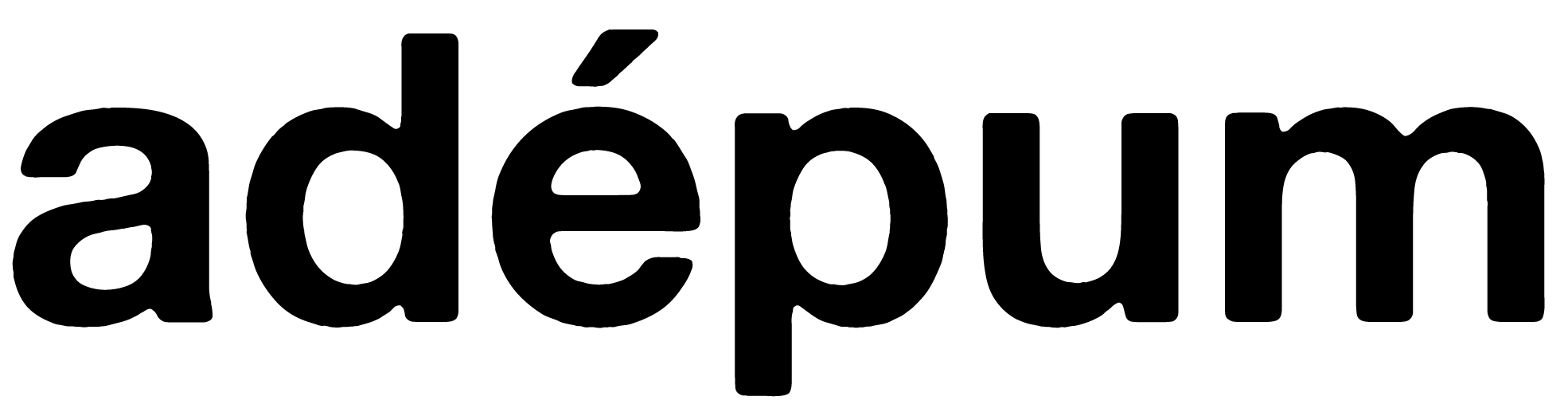Philosophie et environnement
L’accélération des changements climatiques anthropiques et la perte de la biodiversité sont parmi les défis majeurs du 21e siècle. C’est à ce titre que l’ONU intègre la lutte aux changements climatiques ainsi que la protection de la vie aquatique et terrestre parmi ses 17 objectifs de développement durable. La question environnementale est au cœur des discours politiques et fait l’objet de grandes conférences mondiales, de politiques publiques et d’accords internationaux. Au-delà des questions empiriques pour les sciences naturelles, elle suscite des questionnements philosophiques fondamentaux sur nos concepts de nature, de vie, de justice, de devoir, et sur notre ontologie. Voici quelques interrogations, enjeux et dialogues qui lient la philosophie aux considérations environnementales, et qui s’étendent sur différents axes.
La philosophie se consacre depuis bien longtemps à la réflexion sur l’environnement et la nature. Déjà, Aristote, au livre I de ses Météorologiques, s’intéresse à l’assèchement progressif des terres et à ses effets sur les populations humaines. Dans son célèbre Walden, le philosophe américain Henry David Thoreau exhorte l’humain à se concevoir comme faisant partie de la nature, et à adopter un mode de vie plus simple et juste. Sans oublier les pensées autochtones ou non occidentales, qui désignent souvent l’environnement comme une source de savoir permettant de résister aux idéologies colonialistes, capitalistes, etc. On peut penser notamment à Frantz Fanon, qui défend dans Les damnés de la terre que la décolonisation concerne la « valeur de la terre » : l’environnement étant ici désigné comme une valeur matérielle qui permet une véritable dignité humaine, tangible, lieu de l’agir. Bref, l’environnement fait partie intégrante de l’histoire des idées et il est important de dégager cette contribution au champ philosophique.
La crise écologique nous pousse également à interroger notre rapport à la nature et à redéfinir notre place au sein de celle-ci. Elle invite à une réflexion profonde sur la nature humaine elle-même. Notamment, Judith Butler, dans Rassemblement, défend que la catégorie de « vie humaine » reste toujours incomplète puisque notre propre vie nous dépasse : la vie est toujours interdépendante et est donc en constante reconstruction (et destruction, dans le cas de guerres, de crises climatiques, etc.). Comment notre compréhension de nous-mêmes influence-t-elle notre interaction avec le monde naturel et les autres formes de vie ? Les dimensions sensibles et affectives de notre interaction avec la nature peuvent-elles dévoiler les implications profondes de la crise écologique sur notre existence quotidienne et notre perception ? Ces interrogations invitent à reconsidérer notre rapport à la nature, non pas comme une ressource à exploiter, mais comme un élément intrinsèque de notre existence et de notre identité.
Depuis les années 1970, la pensée écologique suscite de vifs débats dans plusieurs champs de la philosophie, dont la philosophie des sciences, l’éthique et la philosophie politique. L’étude de l’environnement comporte de nombreux enjeux pour l’épistémologie et la philosophie des sciences. D’abord, la question environnementale traverse les champs disciplinaires vastes des sciences humaines et sociales et des sciences naturelles. Comment concilier et assurer une coopération entre les différentes disciplines et approches ? Quel avenir cela recèle-t-il pour les frontières disciplinaires ?
Sur le plan scientifique, si certaines sciences naturelles sont en mesure de prédire avec précision les phénomènes à partir de certaines conditions de base, les changements environnementaux que nous voyons poindre sont difficilement prévisibles, notamment en raison de leur caractère singulier. Quelle est donc la valeur des modélisations et des prédictions en matière de changements climatiques ? Comment communiquer adéquatement les fruits de ces recherches ? Comment éviter le climatoscepticisme ?
Sur le plan ontologique, l’environnement regroupe un ensemble d’entités et de concepts dont les frontières et l’existence sont hautement contestées. En effet, l’écologie et les sciences de l’environnement font intervenir des concepts tels que ceux d’espèces, de populations et d’écosystèmes. C’est ce genre de concepts qu’Anna Tsing remet en question dans Le champignon et la fin du monde. Elle propose de concevoir les environnements comme des assemblages plutôt que comme des concepts fixes, afin de rendre compte de l’aspect créatif des écosystèmes. Comment doit-on poser les frontières des concepts environnementaux en philosophie ? Doit-on concevoir, comme le veulent certains holistes, l’environnement comme un tout homogène, ou s’agit-il plutôt d’une multitude d’écosystèmes interconnectés, chacun ayant ses propres caractéristiques ? Les notions d’écosystèmes, de populations et d’espèces correspondent-elles à des réalités objectives indépendantes de nos descriptions ? En d’autres mots, la science de l’environnement doit-elle être descriptive ou normative ? Quel doit être le rôle des biologistes qui voient leurs objets de recherche disparaître sous leurs yeux ?
Sur le plan moral, quels sont nos devoirs envers l’environnement ? La notion selon laquelle seul l’être humain peut être l’objet de considérations morales est remise en question par plusieurs philosophes de l’éthique environnementale comme Val Plumwood et Richard Routley. Le courant antispéciste est également un bon exemple de cet argumentaire. Notamment, Jacques Derrida (L’Animal que donc je suis) rejette le terme « animal », qu’il trouve simplificateur et oppressif : en désignant l’animal comme l’Autre, on postule non seulement que l’humain et l’animal sont fondamentalement différents, mais aussi que les intérêts des humains seront toujours supérieurs à ceux de l’animal. Suivant cette idée, Peter Singer (Libération animale), cette fois à partir du paradigme utilitariste, défend que nous devons étendre le principe d’égalité des intérêts aux animaux. On comprend ainsi que plusieurs militent en faveur d’une conception élargie de l’éthique, non anthropocentrée, qui prendrait en compte les intérêts des autres vivants dans notre morale.
Enfin, sur le plan politique, les enjeux de justice environnementale sont inextricablement liés aux questions d’inégalités sociales. En effet, les populations et pays les plus vulnérabilisés sont également les plus affectés par les effets négatifs du réchauffement climatique alors qu’elles n’en sont pas les principales responsables. À qui doit-on imputer les devoirs environnementaux et les coûts associés à la transition énergétique ? Quelles responsabilités environnementales nous incombent ? Quel espoir pouvons-nous et devons-nous porter envers la justice environnementale et climatique ?
La réflexion environnementale traverse plusieurs champs de la philosophie. Nous vous en présentons quelques exemples, mais notre appel de textes ne s’y limite pas : histoire de la philosophie, philosophie des sciences, philosophie de la biologie, philosophies écoféministes, philosophies décoloniales et autochtones, éthique de l’environnement, philosophie politique.
Nous vous invitons à explorer les problématiques philosophiques complexes que suscite l’environnement. Les personnes intéressées peuvent soumettre leur texte en lien avec la thématique du numéro à l’une ou l’autre des rubriques suivantes :
Érudite
Longueur des articles : 13 000 à 17 000 caractères espaces compris
Publication d’articles de vulgarisation des recherches actuelles en philosophie ayant une affinité avec la thématique du dossier. Cette section veut rendre accessible le savoir issu de la recherche en philosophie. Les articles de recherche, les commentaires critiques et les recensions de la littérature sont acceptés dans cette section à la condition que le lien avec le dossier thématique soit présent et explicite.
Argumentée
Longueur des articles : 10 000 à 12 000 caractères espaces compris
Publication de courts articles ayant pour but de défendre une prise de position philosophique en lien avec le dossier thématique. Cette section est propice au débat public sur des sujets d’actualité. Dans cet ordre d’idées, il est possible de répondre à des publications des dossiers précédents de la revue dans cette rubrique.
Créative
Longueur des articles : 1-3 pages ou 4 000 à 8 000 signes
Espace accessible et ouvert aux réflexions philosophiques de tout acabit soulevées par la thématique du dossier. Les propositions ayant une forme moins conventionnelle en philosophie sont encouragées (bande dessinée, fiction, poésie, conte, etc.).
Collégiale
Longueur des articles : 10 000 à 12 000 caractères espaces compris
Publication d’articles ayant pour but d’introduire les lecteurs à une notion ou une idée philosophique soulevée par la thématique du dossier. L’objectif de cette rubrique est de fournir aux professeur.e.s du collégial du matériel adapté à leur pratique et accessible à leurs étudiant.e.s.
Date de tombée : 1er février 2025
Pour soumettre une proposition, veuillez consulter la section « Contribuer » de notre site web afin de respecter les normes éditoriales de la revue. Veuillez ensuite envoyer vos textes à l’adresse : info@lampadaire.ca. Dans votre courriel de soumission, prière d’indiquer votre nom, la rubrique choisie (érudite, argumentée, créative ou collégiale), votre affiliation institutionnelle et votre programme d’étude (si applicables). Veuillez prendre note que seuls les fichiers qui respectent les normes éditoriales et qui sont soumis en format Markdown, Word, LibreOffice, LaTeX, RTF ou TXT sont acceptés.